CREDIT, CAPITAL FINANCIER ET CRISE
Publié par admin on Jan 13, 2013 | 2 commentaires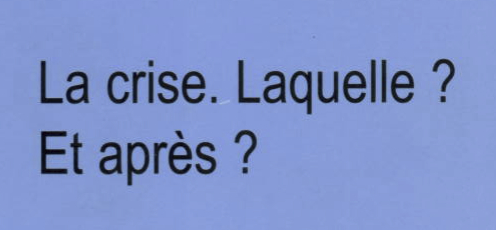
CHAPITRE 3 du livre de Tom Thomas « La crise. Laquelle? Et après? »
3.1 Formation d’un système de crédit et d’un capital financier
Avec le développement du crédit, il se forme une sphère financière, un système financier organisé pour gérer un capital financier, de l’argent qui semble fonctionner comme un « vrai » capital. Vrai, il ne l’est cependant que dans la conception bourgeoise du capital, à savoir de l’argent qui produit de l’argent. Cette sphère financière serait celle de la valorisation d’un capital particulier, le capital financier, à côté d’autres où se valoriseraient le capital industriel ou le capital commercial. Toutes ces sphères sont reliées entre elles par des échanges, des affaires réciproques. Toute crise de l’une se répercute sur les autres bien que celles-ci n’y soient apparemment pour rien puisque les procès de valorisation sont vus comme séparés. Ainsi aujourd’hui, toutes seraient victimes de la finance et des financiers. On affirme qu’elles étaient en bonne santé et qu’elles ont été contaminées par les excès en tous genres de la sphère financière. En réalité, la suraccumulation du capital était partout généralisée, cela, quelles que soient les séparations formelles des différentes branches de la production ou des différents moments du procès de valorisation (mobilisation de l’argent, investissements, production, commercialisation, etc.). Chacune de ces fractions n’est en fait qu’un des éléments de ce procès général de la reproduction du capital confiés à des capitaux spécialisés et à leurs fonctionnaires (agents) spécialisés.
Pour bien comprendre que, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, la crise actuelle est celle du capitalisme (un rapport de propriété, un mode de production, une société) et non d’une seule des fractions particulières du capital, il faut reprendre l’analyse de ce qu’est ce capital financier31, non seulement pour montrer son contenu, mais aussi les limites de son extériorité, de son autonomie par rapport au capital productif de plus-value. Sur cette base, on pourra conclure s’il est possible ou non de corriger les « exagérations » du capital financier et en quoi ces éventuelles corrections constitueraient un moyen de relancer la valorisation du capital. Ceci ne serait d’ailleurs qu’une « solution bourgeoise » à la crise.
La finance est le monde de la circulation de l’argent. C’est le lieu où l’argent semble produire de l’argent. L’extériorité relative ou autonomie du capital financier existe avant même qu’il n’existe comme tel car elle est inhérente à la forme argent en général. En effet, comme on le sait, les marchandises ne peuvent s’échanger que par l’intermédiaire d’un étalon, d’un équivalent, d’une marchandise jouant ce rôle, faisant office d’étalon. Cette marchandise, cet équivalent général, n’est autre que l’argent (une monnaie). D’où plusieurs conséquences, dont les deux suivantes:
1°) ce médiateur de l’échange est extérieur à la richesse produite. Il représente sa valeur, c’est-à-dire la quantité de travail social qu’elle contient, et cela de façon imaginaire, purement conventionnelle dès qu’il s’agit de monnaie fiduciaire ou scripturale. Cette extériorité fait qu’il peut être émis de cette monnaie une quantité quasi illimitée. Il suffit de faire tourner « la planche à billets ». Le crédit est justement le moyen essentiel pour qu’une telle émission se fasse. Cette indépendance formelle de la monnaie par rapport aux marchandises entre toutefois en contradiction avec une dépendance réelle;
2°) la contradiction monétaire réside dans la double fonction de la monnaie32. D’abord, en tant que signe médiateur indiquant les proportions de l’échange. Peu importe alors sa valeur. En effet, si une quantité x de marchandise B s’échange contre une quantité y de marchandise C, en valeur on a xB = yC. Peu importe qu’on convienne que xB = 100 euros = yC, ou que xB = 1000 euros = yC. On peut émettre autant de signes qu’on veut sans que cela change quoi que ce soit aux valeurs échangées et donc aux proportions de l’échange à un moment donné. Mais la monnaie a aussi une deuxième fonction. En tant que représentante de la valeur, elle est censée la conserver. Or s’il est émis plus de monnaie que de valeurs produites et échangées, c’est-à-dire si la masse monétaire en circulation augmente plus que celle des valeurs échangées, alors l’unité monétaire ne représente plus la même valeur. C’est le phénomène bien connu de l’inflation monétaire. Dans ce cas, le vendeur de xB qui en recevrait 100 euros ne pourra acheter plus tard, après une telle émission monétaire, que moins que les yC pour le même prix nominal. Ce phénomène peut se produire parce que la médiation de l’argent implique la séparation des actes d’achat et de vente et permet donc qu’elle recouvre un grand laps de temps. Nous verrons que le crédit, en tant qu’il est création monétaire privée, est un puissant facteur d’inflation (d’augmentation des prix nominaux), et tout particulièrement d’inflation de la masse financière (quantité et prix des titres financiers).
C’est parce que l’argent se présente non seulement comme signe étalon médiateur des échanges, mais aussi comme représentant de la valeur pendant le temps qui sépare la vente d’une marchandise de l’achat d’une autre qu’il se présente aux yeux des agents comme étant lui-même la valeur33. Il apparaît même comme la valeur suprême puisqu’elle seule peut s’échanger contre toutes les autres, puisqu’il peut tout acheter. Et la forme argent, cette « forme autonome de la valeur » comme disait Marx, permet ensuite l’existence du crédit. Celui-ci n’est rien d’autre qu’une création et une circulation d’argent relativement détachées de celles des marchandises. Et il s’en détachera toujours davantage… jusqu’à ce qu’une crise advienne qui dégonflera cette suraccumulation là aussi. Le crédit est possible grâce à cette forme argent de la valeur (de la richesse sociale). En même temps, il permet d’en démultiplier la création.
Nous avons rappelé au chapitre 2 les principales raisons qui ont contraint au nécessaire développement du crédit. Mais celui-ci n’aurait pu se développer sans l’organisation concomitante d’un système de crédit, c’est-à-dire d’un ensemble d’institutions spécialisées (banques, bourses, etc.), de règles et de lois assurant la création et la gestion du crédit. Assurant donc notamment cette triple fonction:
– une fonction de « fabrication » du crédit (création monétaire), ainsi que de transformation de cette monnaie privée en « vraie » monnaie d’Etat par divers moyens tels l’escompte ou la titrisation;
– une fonction de collecte de l’épargne et de sa concentration en capital sous sa forme argent afin d’accompagner et stimuler sa concentration sous ses formes matérielles;
– une fonction de circulation de ce capital (accélération de la rotation et de la mobilité).
Le capital financier se sépare formellement comme tel du capital productif au fur et à mesure que se structurent et se spécialisent les institutions financières. C’est un capital fait de titres de créance sous forme de dépôts bancaires variés, de titres financiers privés ou publics, cotés ou non, de contrats de ventes ou d’achats à terme, ou encore d’innombrables « produits dérivés » créés par la finance contemporaine. Quelle que soit cette forme, il s’agit toujours d’un titre de papier qui représente une somme d’argent censée s’accroître sans que son possesseur n’ait à se soucier de la convertir en moyens de production. Notons que cette somme peut fort bien n’être que virtuelle et « l’investisseur » ne toucher que le gain… ou subir la perte. Tel est le cas dans les opérations à terme faites à crédit qui nourrissent la spéculation (le crédit et la spéculation sont inséparables). Ces titres financiers se distinguent de la simple monnaie en ce qu’ils sont censés rapporter dividendes ou intérêts. Mais ils sont convertibles le plus souvent quasi instantanément en monnaie et réciproquement. En ce sens, argent ou titres sont des signes monétaires, c’est-à-dire une créance sur une part de la richesse sociale. Ensemble, ils sont ce que les économistes appellent « des liquidités », à la différence du capital existant sous la forme solide et fixe de moyens de production.
En premier lieu, la sphère du capital financier pleinement constituée du capitalisme moderne est celle d’où part l’argent A. Elle le fournit aux autres sphères du capital d’où il revient gonflé d’intérêt ou de dividende, comme A’ supérieur à A. La sphère du capital financier semble ainsi être la sphère du capital par excellence puisque c’est là que semble se passer la valorisation de A en A’. Bien évidemment, intérêt et dividende ne sont que cette part de la plus-value réalisée qui est distribuée aux financiers. L’autre part est affectée à des investissements supplémentaires (accumulation), ainsi qu’aux impôts, aux rémunérations des cadres supérieurs, au paiement des couches improductives, aux dépenses somptuaires diverses, etc. Pourquoi une part de cette pl va au financier, capitaliste passif, simple prêteur? Parce qu’il a conservé la propriété de l’argent. Il n’en a concédé que l’usage au capitaliste actif. Et cet usage consiste à le transformer en moyens de produire la pl. Comme dans les grandes entreprises d’aujourd’hui, tout le capital argent est du capital de prêt, il semble que tout le profit distribué va au financier. En réalité, les managers, capitalistes actifs, reçoivent aussi leur part de pl sous forme de stock-options, d’intéressement aux bénéfices, de hautes rémunérations, d’avantages en nature, etc. Mais comme il semble que toute la pl va aux financiers, que la valorisation A-A’ se passe dans la sphère financière, qu’elle ne concerne et ne profite qu’aux propriétaires de l’argent, il semble aussi que les capitalistes actifs, qui maîtrisent les moyens de production et organisent l’extorsion du surtravail et sa transformation en pl, n’en reçoivent pas une part et ne sont au pire que des exécutants obligés et dociles de financiers avides, égoïstes et dictatoriaux.
Du fait que c’est lorsque le capital revient sous sa forme argent que l’on sait s’il y a eu ou non valorisation, c’est évidemment en tant que capital financier qu’est définie la rentabilité du capital. C’est donc aussi de là que partent les décisions de poursuivre ou non le procès de valorisation réel, à tel endroit, pour tels produits, etc. Ainsi, c’est le capital financier qui paraît se subordonner le capital productif, d’autant plus qu’il en nomme les dirigeants. En réalité, ce n’est pas le capital financier qui décide. Ce sont les conditions qui assurent le profit maximum. Et les dirigeants sont choisis en fonction de leur capacité à les mettre en œuvre. Le capital financier comme le capital en fonction, et donc leurs agents, sont soumis à ces conditions, à cette loi générale inexorable et incontournable du capital, inhérente au rapport social de l’appropriation privée. C’est ce rapport qui exerce sa dictature, s’il faut employer ce terme cher en la matière aux démagogues de la gauche, prompts à dénoncer à grands cris la dictature de la seule finance pour sauvegarder en catimini le capital dans son essence.
A vrai dire, l’argent n’est même pas du capital; au mieux, c’est du capital virtuel. Ce n’est que dans les métamorphoses de l’argent en toutes les conditions de la production de pl, et si elles réussissent jusqu’à la vente, qu’il se transforme en capital, en procès de valorisation. Karl Marx faisait une remarque très pertinente du même ordre à propos de l’argent sous forme de titres financiers, telles les actions, par exemple, qui sont «… un duplicata du capital réel, (des) chiffons de papier, comme si un certificat de chargement pouvait avoir une valeur à côté du chargement, et en même temps que lui… le capital réel existe à côté d’eux et ne change absolument pas de mains si ces duplicata passent d’une main dans une autre »34. Ce dédoublement du capital réel, de la valeur réelle dans un titre de propriété, est typique du capital financier. C’est du capital de papier, du capital fictif.
Mais ce dédoublement peut lui-même être dédoublé par l’émission de titres représentant d’autres titres, ou même simplement, les variations de leurs prix. En fait, nous allons voir qu’avec le crédit, il se produit sur une grande échelle une sorte de démultiplication du capital financier sur lui-même. Il semble pouvoir grossir de façon autonome, beaucoup plus vite et beaucoup plus massivement que le capital en fonction dont il était censé initialement représenter la valeur sous forme argent dans le moment dit de la circulation. Grossissement effectif d’ailleurs, jusqu’à ce qu’un krach vienne démentir ce découplage. Avant d’analyser le rôle de cette hypertrophie des titres financiers dans la crise, il convient donc de rappeler d’abord l’existence de ce processus, et d’en rendre compte.
3.2 Puissance d’expansion autonome du capital financier
La première chose qu’il faut avoir en mémoire en ce qui concerne le crédit, dont les titres forment le capital financier, est qu’il se développe d’abord selon les besoins des agents économiques, de leurs activités. Le crédit est une création privée de monnaie. Ses premières formes, tels la lettre de change et le billet à ordre, pouvaient déjà servir de monnaie pour d’autres transactions en étant endossées. Aujourd’hui, les banques sont les principales créatrices de monnaie qu’elles fournissent aux agents économiques à qui elles ouvrent un crédit. Rappelons brièvement comment.
En général, le public croit que les banques prêtent l’argent qu’elles ont dans leurs coffres. Absolument pas. Leurs capitaux propres et les dépôts dont elles disposent ne représentent qu’une faible part de l’argent qu’elles prêtent35. Elles prêtent de l’argent qu’elles créent. On en comprend facilement le mécanisme en supposant, pour simplifier, une banque unique représentant le système bancaire dans sa globalité. Elle accorde un crédit à Mr. A. Cela veut dire qu’elle donne à Mr. A le droit de tirer un chèque sur la banque, par exemple, pour l’achat d’une maison à Mr. B. Comme Mr. A n’avait pas l’argent nécessaire sur son compte avant ce crédit, il devient « pour la banque, un déposant imaginaire »36: simple jeu d’écriture. Selon le vieil adage des banquiers, « ce sont les crédits qui font les dépôts et non l’inverse ». En effet, la banque inscrit à l’actif de son bilan sa créance sur Mr. A et au passif un dépôt nouveau. En fait, le vendeur Mr. B remettra le chèque qu’il a reçu de Mr. A à la banque et le dépôt sera à son nom. Le bilan de la banque a gonflé du montant de cette création monétaire mais « il n’y a eu ici aucune intervention de billets »37, de monnaie d’Etat, rien que des écritures dans les bilans des banques et les comptes courants de leurs clients38. Ce schéma, valable dans le cas d’une banque unique, demeure tout aussi valable dans un système à banques multiples car, dans ce cas, chacune des banques reçoit en dépôt des chèques tirés sur les autres banques. L’ensemble de ces traites se compensent plus ou moins; l’opération est réalisée par les chambres de compensation; seuls les soldes sont réglés en « vraie » monnaie d’Etat; mais, le plus souvent, ils font encore l’objet de crédits, interbancaires.
La deuxième chose qu’il faut avoir en mémoire à propos de la création monétaire par le crédit, c’est que l’Etat, via sa banque centrale, est obligé, du moins à peu de chose près, de fournir au système financier l’argent « officiel » dont il peut avoir besoin, en reprenant alors les créances que les banques lui confient en échange. L’Etat est, par essence, l’organisateur suprême des intérêts du capital et de la société capitaliste. Il doit et il ne peut que soutenir la croissance (donc l’accumulation du capital) la plus forte possible et veille donc à la création monétaire qui lui est nécessaire. Or en ces débuts du 21ème siècle, 93 % de la création monétaire relève des crédits bancaires, c’est-à-dire de l’initiative privée. 7 % seulement relève de billets et pièces émis par la banque centrale (la planche à billets). Celle-ci a simplement pour rôle de fournir aux banques le « vrai » argent qui peut leur être demandé par les déposants ou dont elles peuvent avoir besoin pour solder leurs opérations entre elles. En temps « normal », la banque centrale accompagne ainsi le développement de la création monétaire privée par l’escompte, échange d’argent contre des créances. Lors des crises, elle doit même accepter de recevoir toutes sortes de créances « toxiques », irrécouvrables, afin que les banques aient assez d’argent pour payer leurs propres dettes (les actifs, dévalorisés ou annulés, ne couvrent plus le passif dont la plupart des ayant droits, sinon tous, réclament le remboursement lors des crises financières). La banque centrale est obligée de garantir la transformation de la monnaie privée en monnaie d’Etat quelle que soit la situation. En période de croissance, car si elle ne le faisait pas, plus personne n’aurait confiance dans le crédit et la sacro-sainte croissance s’écroulerait à la grande fureur du monde capitaliste. En période de crise, elle y est encore plus obligée sinon tout le système financier s’écroulerait, et avec lui le capital dans son ensemble qui ne peut exister, ni se reproduire aujourd’hui sans le crédit. Bref, l’Etat ne peut pas décider de l’évolution de la masse monétaire à sa guise. Il peut certes la stimuler ou la freiner mais, pour l’essentiel, ce sont les maîtres de la production qui en décident selon les exigences des capitaux qu’ils gèrent. Ou plus précisément, avec l’Etat, ce sont les intérêts et les besoins qui découlent du capital en général qui décident au-delà de tels ou tels intérêts particuliers. On le voit aujourd’hui: les Etats décident de relancer la croissance par l’accroissement du crédit en offrant des avances d’argent quasi gratuites. Mais le volume des affaires dégringolant, les capitalistes décident autre chose: ils ne veulent pas de crédit. Ni en faire, ils ont déjà trop d’impayés. Ni en recevoir, ils sont déjà trop endettés. Donc, ils ne prennent cet argent que dans la mesure où ils doivent boucher le trou des impayés et rembourser leurs dettes, pas pour investir en faveur de la croissance. Nous y reviendrons.
Ouvrons ici une parenthèse pour observer que cette création monétaire par le crédit se manifeste sous la forme d’une existence double du même argent: comme argent dont l’emprunteur dispose et comme un nouveau dépôt créé au bilan de la banque en contrepartie d’une créance et sur lequel le titulaire (Mr. B dans notre exemple) peut tirer de l’argent. Une fois encore, on découvre cette caractéristique du crédit de pouvoir dédoubler la représentation d’une même valeur. Et on peut illustrer cela d’une autre façon en retournant contre ses tenants l’idée que ce serait les dépôts des uns qui financeraient les crédits des autres. Car même dans ce cas, ce serait encore reconnaître que le même argent sert deux fois: une fois comme avoir pour le déposant et une fois pour le banquier qui le met à la disposition de l’emprunteur (c’est bien pourquoi, il est « un déposant imaginaire »).
Il est important de bien comprendre que le crédit est une création monétaire induite par les activités des agents privés, agissant selon les rapports sociaux de l’appropriation privée des moyens de production. Sinon, on pourrait se laisser convaincre par les thèses erronées (examinées plus loin au chapitre 4) selon lesquelles tout Etat peut contrôler à sa guise la masse des crédits et, par là, rationaliser le développement du capitalisme. Afin de ne pas se laisser leurrer, insistons sur ce point et développons deux exemples contemporains.
Premier exemple. Le déficit commercial des USA avec la Chine et avec d’autres pays asiatiques, résultat d’échanges privés, aboutit à obliger la banque centrale chinoise à racheter aux exportateurs chinois les dollars reçus par eux et qui ne servent pas aux importations de marchandises US. Donc, cela l’oblige à émettre des yuans. En même temps, avec ces dollars, elle achète des titres de l’Etat US. Début 2009, elle détient environ 1000 milliards $. Ces dollars retournent donc aux USA puisqu’elle les utilise pour acheter des titres US. Là encore, il y a dédoublement. C’est comme si les dollars n’avaient jamais servis. Mais des yuans ont bien été créés ainsi que ces titres de la dette publique US qui viennent gonfler la masse mondiale de capital financier. Les échanges privés entre américains et chinois, financés par du crédit chinois, ont abouti à une création obligée de monnaie publique chinoise et de titres financiers publics US.
Deuxième exemple. Plus généralement, la croissance démesurée des dettes publiques générées par les nécessités de surmonter les difficultés de la reproduction des sociétés capitalistes aboutit à une création tout aussi démesurée de capital financier. L’argent remis aux Etats par leurs créanciers est dédoublé par les titres qui le représentent (Bons du Trésor ou autres). Ces titres dupliquent cet argent mais, comme celui-ci est dépensé pour l’essentiel de manière improductive, ils ne représentent même pas du capital en fonction. Ils ne sont que du capital fictif. « L’accumulation du capital de la dette publique ne signifie rien d’autre… que le développement d’une classe de créanciers de l’Etat, qui sont autorisés à prélever pour eux certaines sommes sur le montant des impôts… Ces faits montrent que même une accumulation de dettes arrive à passer pour une accumulation de capital… »39. Les Etats sont ainsi aujourd’hui les principaux créateurs de capital financier fictif dont, par ailleurs, leurs dirigeants se plaisent à dénoncer l’exubérance irrationnelle et néfaste!
Mais ils y sont obligés par leur fonction. Ils ont en effet à organiser la valorisation du capital et la reproduction de la société capitaliste. Il s’ensuit un déluge de subventions, d’exonérations fiscales et d’aides diverses aux entreprises, et un autre déluge de dépenses pour contenir la lutte de classe (un peu d’aides sociales, beaucoup de police, énormément de coûteuses bureaucraties administratives et politiciennes). Et ils y sont encore plus obligés par la crise puisqu’ils doivent alors absolument sauver le système financier en déroute du fait de l’hypertrophie de capital financier fictif que les agents privés ont causé par le crédit.
Hypertrophie exacerbée40 par le fait que les titres de crédit peuvent être émis presque à volonté, comme si le capital financier se démultipliait par lui-même. Ainsi, des titres financiers servent de « sous-jacents » pour donner naissance à d’autres titres qui les dupliquent, comme par exemple ces titres de fonds qui rassemblent d’autres titres (actions ou obligations) et qui, eux-mêmes, sont dupliqués par des titres de fonds de fonds qui les rassemblent! Mais surtout le crédit permet toutes les spéculations à « effet de levier »41. En effet, la grande masse des produits financiers, dont il est impossible de connaître tout l’enchevêtrement et la complexité (y compris pour les spécialistes), sont le plus souvent fondés sur des opérations et des engagements à terme. On ne les paie pas cash. Une masse énorme de toutes sortes de « produits dérivés » a ainsi été créée. Ces produits ont pour caractéristiques communes d’être de simples paris sur les variations futures de leurs « sous-jacents ». Ces derniers peuvent être des actifs matériels ou financiers, voire de simples « notions » comme l’indice CAC 40 ou un taux de change ou d’intérêt. Ils peuvent être achetés pour des mises de fonds initiales extrêmement faibles; la perte ou le gain ne se faisant qu’à terme en fonction de l’ampleur des variations constatées. Ainsi, gains ou pertes peuvent atteindre 10 ou 100 fois la mise de fonds initiale. Tous ces contrats à terme sont un bon exemple du caractère fictif de ce capital financier, puisqu’ils ne sont que de la pure spéculation et puisqu’on peut gagner de l’argent sans même en avancer, ou alors très peu. Nous verrons plus loin le rôle de cette hypertrophie du capital financier dans la crise, accentuée par une inflation quant aux prix des actifs (ce qui diminue leur rendement). Mais lorsque ce capital s’écroule, il faut sauver le système financier et c’est alors la dette publique qui s’accroît à proportion.
Rappelons seulement à ce propos que l’encours mondial des seuls produits dérivés était de 516 000 milliards $ à la fin 200742. D’autres produits financiers d’invention récente, les contrats « swap » (échanges de risques financiers en tous genres) ont connu une progression fulgurante. Rien que ceux portant sur des risques d’insolvabilité de débiteurs, les fameux CDS (credit default swap), sont passés de 0 à 60 000 milliards $ entre 2000 et 200843. Ces sommes sont à comparer à celle de 167 000 milliards d’actifs financiers supposés représenter un capital « réel », encore que les « experts » appellent capital « réel » un investissement dans n’importe quelle activité non financière, productive ou non de pl. Il y a bien d’autres « bombes oubliées », pour reprendre l’appellation maintenant donnée aux fameuses opérations à effets de levier dites « L.B.O. » (leverage buy out): « Le L.B.O. est désormais La Bombe Oubliée ». Par exemple, « si les banques françaises avaient encore 22 milliards d’euros d’actifs pourris liés aux subprimes après 25 milliards de dépréciations en 2007-2008, elles détenaient 28 milliards de prêts L.B.O. provisionnés à hauteur de seulement 2 milliards. Un baril de poudre qui n’attend plus qu’une poignée de mèches »44.
Ces exemples ont pour objet de donner une idée de l’hypertrophie du capital financier, fictif. Peu importe finalement de connaître tout l’éventail de ses « produits ». Il suffit de le constater et d’en connaître le support: le crédit, dont nous avons montré l’origine et la nécessité dans les rapports marchands et capitalistes. Tous les économistes reconnaissent aisément que l’excès de crédits est ce qui forme ces bulles financières qui éclatent en krachs. Mais ce constat n’est rien tant il crève les yeux. Il laisse sans réponse deux questions essentielles: 1°) pourquoi ce phénomène se produit de façon récurrente sans que les Etats ne puissent l’empêcher? 2°) Quel est le rôle de cette hypertrophie dans la crise généralisée du capitalisme? Nous avons déjà répondu à la première. Faisons le pour la seconde.
3.3 Le rôle du capital financier dans la crise
Nous avons déjà rappelé que le développement du crédit s’expliquait d’abord comme une contre-tendance à la baisse du taux de profit et qu’il contribuait à plus long terme à l’accentuer. En effet, en accélérant et stimulant le développement du procès de valorisation, il accentue également ses contradictions internes: il accroît la productivité et développe la contradiction suraccumulation/sous-consommation.
Maintenant, nous pouvons ajouter que la tendance irrépressible du crédit et du capital financier à se démultiplier implique évidemment le gonflement de la masse de l’intérêt qui doit rémunérer tous ces titres. Comme finalement, l’argent ne vaut que par rapport à la valeur de la richesse réelle qu’il représente et que, de la même façon, il ne représente une valeur se valorisant (un capital) par l’intérêt que dans la mesure où celui-ci est une part d’une plus-value réelle, on voit que le gonflement du capital sous forme financière ne fait qu’accroître la masse d’argent qui se veut capital et exige de recevoir une part de la plus-value. Comme le capital financier n’en produit pas, son gonflement a pour conséquence de diminuer le taux de profit moyen pour tous les capitaux45. De plus, il faut inclure dans cette diminution du taux de profit les faux-frais pour le capital que sont les coûts nécessaires au fonctionnement du vaste système financier.
Marx a montré46 que le profit général était, en résumé, la somme de l’intérêt (ou du dividende, qui est pour lui, à juste titre, la même chose, c’est-à-dire la contrepartie de la cession de la valeur d’usage de l’argent), des profits et de la rente foncière. Cela étant, la masse de ce profit n’est pas affectée par la façon dont elle se répartit entre ces différents ayants droit. Mais le taux l’est si cette masse n’augmente pas proportionnellement à celle des capitaux « ayants droit ». Et Marx ne pouvait pas imaginer à son époque à quel point la masse de capital financier augmenterait au delà de celle du capital productif.
Le paradoxe, c’est que dans une première phase précédant la crise, plus le capital a du mal à se valoriser dans un procès de production, plus cela stimule, en guise de contre-tendance, le gonflement du crédit et donc du capital financier fictif. Cela produit une sorte « d’effet de ciseaux » qui finalement renforce la baisse du taux de profit: le capital productif de pl ne s’accumule plus que lentement (effet de la suraccumulation de ce capital) à l’inverse du capital financier fictif, consommateur d’une plus-value qu’il ne produit pas. De sorte que la phase précédent la crise apparaît néanmoins d’abord, grâce au crédit, comme une phase de valorisation du capital en général, parce que les prix des actions et autres actifs financiers montent, les bourses sont euphoriques grâce notamment aux OPA et aux spéculations, et parce que la consommation dopée au crédit soutient artificiellement la production. Ce que perçoivent les agents économiques, c’est qu’il y a bien accumulation de capital, mais ils ne la comprennent pas comme étant surtout une accumulation de capital fictif, un excès de crédits.
Dans cette phase euphorique, il se produit une sorte d’auto-valorisation du capital financier. La hausse du prix de ces actifs ainsi que de l’immobilier attise l’intérêt des épargnants, petits et grands. La demande de crédit augmente. Les banques s’empressent de la satisfaire. Elles sont soutenues en cela par les banques centrales des Etats qui doivent, même si elles disent parfois le contraire, faciliter le crédit en offrant des liquidités abondantes et bon marché. Par ailleurs, elles ont trouvé le moyen de se débarrasser de leurs créances sur le marché financier en les titrisant47, ce qui leur fournit de l’argent pour de nouveaux crédits. C’est la spirale de la hausse. Le crédit est d’autant plus facilement accordé que la hausse des prix des titres financiers sert de contrepartie pour en obtenir plus et acheter d’autres actifs. Achats qui font encore monter leurs prix et ainsi de suite jusqu’au krach qui révèle le caractère purement spéculatif et artificiel de cette hausse auto-entretenue par ce mécanisme de crédit qui n’est garanti que sur des actifs, eux-mêmes achetés à crédit. Toute nouvelle créance est ainsi garantie par une créance antérieure, comme les cartes d’un château de cartes.
Cet « effet de levier » (ou effet démultiplicateur) du crédit a atteint des niveaux considérables. Les banques et autres fonds d’investissements « ont investi en moyenne sur la base d’un ratio de 24 à 1 entre capitaux extérieurs (empruntés) et capitaux propres »48. La banque Lehman Brothers, célèbre pour sa retentissante faillite en 2008, était championne en cette matière: « 677 milliards de dettes pour 23 milliards de capital fin 2007 »49, soit environ 1 dollar apporté contre 29 empruntés pour un investissement de 30! Ce qui signifie évidemment un profit énorme quand tout va bien et, à l’inverse, une perte tout aussi énorme en cas de mauvaises affaires: il faut alors rembourser 24 ou 29 en plus du 1 perdu. Ce qui veut dire vendre d’autres titres ou actifs matériels. Mais comme dans la crise, tout le monde veut vendre en même temps, pressés par les créanciers de rembourser les dettes50, obligés de combler les trous de leurs propres créances devenues irrécouvrables, tous les prix s’effondrent et c’est l’insolvabilité générale qui se développe. Le crédit s’effondre. Spirale de la hausse ou spirale de la baisse, « dans les deux cas, la rationalité individuelle produit l’instabilité collective »51. C’est ainsi que plus de 50 000 milliards de dollars sont « partis en fumée sur les marchés financiers en 2008 »52.
Pour en revenir à l’effet de ciseaux évoqué ci-dessus, on voit bien que l’accroissement de la masse monétaire induit par l’accroissement du crédit produit de l’inflation. Celle-ci n’a pas disparu, contrairement à ce qu’ont affirmé nombre d’experts. Simplement, elle s’est portée sur les prix des actifs financiers et immobiliers (bases des rentes) plutôt que sur ceux des biens de consommation. Ce qui est encore, nous le verrons, une manifestation de la suraccumulation du capital (et de la mondialisation qui l’a accompagnée), qui a induit une concurrence plus acharnée et une tendance déflationniste du prix des marchandises produites massivement.
Ce gonflement de la masse des titres financiers et de leurs prix finit par produire une baisse du taux de profit moyen, non seulement comme nous l’avons dit ci-dessus à cause de la démultiplication des ayants droit au partage des profits, mais aussi parce que la hausse des prix de ces titres abaisse mécaniquement leur rendement (le ratio taux intérêt/somme investie pour l’achat du titre). Et cette baisse des rendements, rendements qui sont pour les capitalistes passifs les seuls taux de profit qu’ils connaissent et qui motivent leur décision d’investir ou non, conduit les Etats et les banques à augmenter davantage encore l’émission de crédits dans l’espoir de la contrer. Ces crédits deviennent alors nécessairement de plus en plus risqués. Au point que le risque tourne en catastrophe comme ce fut le cas pour les désormais célèbres « subprimes » aux USA et ailleurs. Mais ce qui est apparu comme un excès de crédits dans le secteur immobilier n’était que la partie émergée de l’iceberg. L’excès était généralisé et mondial comme l’a prouvé l’effondrement de tout le système du crédit. Et cet effondrement du système financier s’est révélé être en fait une crise généralisée du capitalisme comme l’a prouvé la mise en évidence par cette crise de la suraccumulation/sous-consommation. Cette évidence, la quasi totalité des économistes n’arrive toujours pas ou ne veut toujours pas la reconnaître. Ces économistes ne parviennent toujours pas à aller au-delà des apparences.
Qu’est-ce qui fait que la crise leur apparaît comme due aux « excès » de la finance, à l’hypertrophie anarchique du crédit, aux manœuvres folles de traders cyniques avides de bonus, bref, à des causes limitées à la sphère financière? C’est que non seulement tous ces faits sont réels, mais ils sont aussi les plus immédiatement visibles; ils crèvent les yeux, tandis que les raisons profondes qui les engendrent et les nourrissent ne le sont pas et exigent un travail scientifique d’analyse et d’approfondissement tel celui entrepris par Marx dans le Capital.
Il est exact que toute crise de l’époque capitaliste apparaît dans la sphère financière, celle de la circulation de l’argent. Il en est ainsi parce que c’est sous la forme argent que le capitaliste « entreprend ». C’est aussi sous la forme argent qu’il découvre plus tard si son entreprise a ou non atteint son but, c’est-à-dire s’il a ou non récupéré plus d’argent qu’il n’en avait misé au départ. Ainsi, il ne connait la validité de ses choix qu’après la phase de production proprement dite. Et dans le capitalisme moderne, où tout le procès de valorisation est fondé essentiellement sur le crédit, c’est l’insolvabilité massive des emprunteurs qui annonce, après coup, qu’il y a eu suraccumulation de marchandises et de moyens de les produire, relativement à la production-réalisation de profits. C’est pourquoi la crise apparaît d’abord dans la sphère financière comme un effondrement des titres de crédit.
Mais est-ce pour autant que la cause de la crise est financière, qu’elle réside dans ces excès de crédits? La réponse à cette question se trouve déjà dans les analyses précédentes. Cependant, il est utile d’y revenir maintenant de façon spécifique parce que tous les idéologues bourgeois, économistes, politiciens, journalistes, n’ont cessé de mettre en cause non pas le capital, mais la finance et les financiers, non pas le capitalisme mais le libéralisme. Il convient donc d’accorder une attention particulière à cette question et de s’opposer à cette escroquerie qui a pour but, conscient ou non, peu importe, de conserver et de reproduire le capitalisme sous une forme qu’ils nous promettent évidemment bien meilleure.
3.4 Crise financière ou crise du capitalisme?
Il suffit de regrouper les résultats obtenus dans les chapitres précédents pour comprendre que la crise financière ne s’explique que dans le cadre de la crise du mode de production capitaliste53 en général. On le constatera en effet en résumant ce que nous savons sur le crédit, dont les titres constituent la base du capital financier.
– Il a sa possibilité dans le fait que la valeur d’une marchandise (la quantité de travail social qu’elle contient) ne peut se connaître que dans l’échange avec une autre, l’argent (la monnaie) qui lui est extérieure. Avec l’argent, la valeur, forme de la richesse dans le capitalisme, acquiert une existence sociale autonome par rapport au travail social qui en est le fondement.
– Cette possibilité se développe en une réalité de plus en plus impérieuse, en même temps que les forces productives, l’accumulation et la concentration du capital, comme une contre-tendance à la baisse du taux de profit.
Ce qui produit le crédit, sa nécessité, son extension découle donc des rapports sociaux de la propriété privée des moyens de production qui induisent l’argent comme médiation dans les échanges de marchandises, ainsi que la tendance à la baisse du taux de profit qui rend le crédit indispensable pour la contrecarrer.
Ceux qui le produisent sont les agents privés propriétaires de ces moyens. Et ils le produisent comme monnaie, selon les besoins, l’ampleur de leurs activités et de leurs échanges, selon leur but personnel qui est la production maximum pour un profit maximum. La rationalité individuelle des agents privés entre ainsi en contradiction avec leur intérêt collectif puisqu’elle aboutit constamment à une production anarchique, pléthorique et de plus en plus mécanisée (donc réduisant la quantité de travail vivant employé relativement à cette pléthore de moyens de production et de marchandises). Il s’agit de comportements qui, là encore, sont inhérents à cette propriété privée.
Ce que le crédit produit, c’est:
1°) le dopage du procès de valorisation du capital (production et réalisation de la pl) et de son accumulation. C’est pourquoi Marx qualifie à juste titre le système de crédit de « système artificiel d’extension forcée du procès de reproduction »54. Ce faisant, il dope aussi toutes les contradictions de ce procès, jusqu’à finalement, le faire de la tendance à la baisse du taux de profit qu’il contrecarrait initialement:
2°) la constitution d’un capital financier qui gonfle d’autant plus que les titres qui le composent peuvent se démultiplier sur eux-mêmes (« produits dérivés ») jusqu’à un certain point: le krach financier qui vient acter qu’il ne s’agissait là que d’un capital fictif (au mieux dédoublant un capital réel, au pire de la pure spéculation, paris sur des évènements futurs telles que des insolvabilités, des variations de taux, d’indices, de prix, etc.). Cette masse de capital financier contribue à accentuer la tendance à la baisse du taux de profit, au-delà des hausses boursières momentanées auto-entretenues et attisées par ces spéculations.
Mais pour autant, l’hypertrophie du crédit et du capital financier n’est pas la cause fondamentale de la baisse du taux de profit. Ils ne font qu’y contribuer, de deux façons conjointes: en l’accélérant et en l’aggravant. Le crédit l’accélère parce que c’est un dopant. Comme la drogue qui améliore d’abord les performances du sportif, puis ensuite le détruit. Il l’aggrave en gonflant la masse de capital fictif, consommateur55 mais non producteur de plus-value. Mais dans tous les cas, les causes profondes de la tendance à la baisse du taux de profit sont internes au procès de valorisation (hausse de la composition organique, diminution relative ou absolue de la masse salariale). Le crédit (le capital financier qui en découle) n’est qu’un facteur externe à ce procès qu’il stimule dans son développement, y compris dans ses effets négatifs pour le capital (pour le taux de profit) qui finissent par prendre le dessus. Il stimule ces effets, il ne les crée pas. Nous en avons rappelé le principal facteur: les hausses de productivité qui finissent par réduire la quantité de travail vivant employée par le capital, sur laquelle repose tout le procès de valorisation (production et réalisation du profit). Hausses qui se manifestent par le phénomène de suraccumulation/sous-consommation dont il a été rendu compte ci-dessus au chapitre 1 (et dont nous avons en particulier montré l’unité, contre les thèses qui séparent les deux aspects pour analyser à tort la crise soit comme surproduction, soit comme sous-consommation).
Constater que l’extension du crédit et du capital financier aggrave les contradictions qui mènent à la crise – et cela d’autant plus qu’elle est gigantesque – n’est pas dire qu’elle les crée. Elle contribue à les pousser jusqu’à l’antagonisme, mais la crise reste le résultat du processus interne du développement de ces contradictions (en même temps qu’elle est le moyen par lequel le capital tente de les surmonter et de reprendre son procès historique d’accumulation). Il n’y a donc pas une cause financière isolée, ni même « principale » à la crise. La crise dans la sphère financière ne peut être qu’une composante d’une crise généralisée du système de la reproduction du capital dans sa globalité, c’est-à-dire de la reproduction du capital comprise dans son procès complet, argent-moyens de production-marchandises-argent.
La contradiction du capital financier est un développement de la contradiction monétaire que nous avons évoquée au début de ce chapitre (cf. section 3.1). La monnaie de crédit démultiplie les titres financiers qui, dans l’imaginaire capitaliste, se veulent capital, s’affirment comme producteurs de valeur, ayant droit à une part de cette soi-disant production, à un profit. Avec le capital financier, l’argent ne se veut plus seulement médiation, étalon représentant la valeur dans l’échange, ni même conservateur dans le temps de cette valeur, mais créateur de valeur. Mais la démultiplication des titres, simples signes de propriété de l’argent – voire même simples signes d’appropriation d’un éventuel gain futur (opérations à terme pour lesquelles presque aucun argent n’a à être engagé, seuls circulent à terme le gain et la perte) – ne démultiplie pas pour autant la production de pl. Or le prix de ces titres financiers n’est pas celui du capital matérialisé qu’ils représentent: il repose sur l’intérêt attendu (il est calculé par capitalisation de ce revenu)56. Cet intérêt n’étant finalement qu’une part de la pl réalisée par le capital productif, la démultiplication des titres financiers, qui eux n’en produisent pas, ne peut qu’aboutir à terme à une diminution de cette part pour chacun, et donc à leur dévalorisation pour tous (d’autant plus que les spéculations fondées sur le crédit qui en ont fait d’abord artificiellement monter les prix, contribuent à en abaisser le rendement). La contradiction du capital financier est ainsi celle d’une multiplication de signes qui se veulent être du capital ou représenter du capital, mais qui est sans rapport avec l’accroissement du capital matérialisé dans un procès de production de pl. Les signes se multiplient sans rapport avec la valeur réellement créée. Jusqu’au moment où le krach vient leur signifier qu’ils n’étaient que du capital fictif. En effet, la démultiplication des titres induit qu’il arrive toujours un moment limite, celui où leur prix s’avère très inférieur au prix payé initialement, voire nul. Cela arrive quand quelque part, dans une branche d’activité, un pays, des débiteurs s’avèrent insolvables pour un total de dettes important (comme, par exemple, ce fut le cas avec les prêts immobiliers « subprimes » aux USA), de sorte que cela entraîne, par effet de dominos, l’écroulement de toute la chaîne des crédits et des dettes réciproques qui relie tous les éléments du système financier57.
Mais si l’incendie qui se déclare dans la chambre financière se répand dans tout le bâtiment capitaliste, c’est bien qu’il y avait de la matière inflammable partout. Il ne faut pas confondre l’origine de la crise au sens de ce qui la déclenche avec l’origine au sens de ce qui en est la cause profonde. Si la crise ouverte par le krach financier se révèle être, en fait, une crise du système capitaliste, c’est que les conditions de la crise existaient bien mûres dans ce système, et c’est que celui-ci est basé sur un vice fondamental qui se développe dans toutes ses composantes. Ce vice, on le connait, ce sont les rapports de l’appropriation privée des moyens de production, qui produisent le capitalisme comme n’existant que s’il y a valorisation perpétuelle du capital, accumulation permanente de moyens de production toujours plus perfectionnés et efficaces, diminution relativement à cette accumulation de la quantité de travail vivant employée. Tous phénomènes qui aboutissent à cette baisse tendancielle du taux de profit à laquelle le crédit finit par contribuer alors qu’il devait s’y opposer.
Nous avons dit pourquoi la crise se déclenchait dans la sphère financière. Le krach ouvre une période au cours de laquelle le capital (ses fonctionnaires) va œuvrer à établir des conditions permettant une reprise du procès de valorisation (un rétablissement du taux de profit). Cette période est celle de la crise globale. Là encore, la question du crédit va jouer un rôle important. Il est évident que puisque tout le système capitaliste ne survivait que sous perfusion massive de crédits qui maintenait ses organes vitaux (bases de la production des profits) en fonctionnement, le « credit crunch » (effondrement de la masse des crédits) qui suit fatalement le krach ouvre une période déflationniste, destructrice de capital. Les prix des marchandises diminuent parce que toutes ont été sur-accumulées et que tout le monde veut vendre pour rembourser ses dettes, combler les impayés. La concurrence s’accroît de ce fait, mais aussi du fait de la crise elle-même. Moins de crédit, c’est moins de consommation (dans le secteur 1 des moyens de production comme dans le secteur 2 des biens courants), donc encore moins de production, donc encore plus de faillites et de chômage, et à nouveau moins de consommation et accentuation de l’effondrement du crédit. Et ainsi de suite, c’est d’abord tout un processus déflationniste auto-entretenu qui est à l’œuvre.
Il est néfaste pour le profit, donc dévalorise et détruit du capital, ce qui ensuite peut finir par constituer un élément favorable au rétablissement du taux de profit58 et à l’accumulation du capital. Mais peut-on en sortir en injectant en catastrophe des milliers de milliards de dollars ou d’euros pour tenter de rétablir les transactions et le système de crédit qui les accompagne? On le croira si on n’a pas compris que le crédit ne peut se développer que si les affaires du capital reprennent, et que les conditions de cette reprise sont d’abord dans le rétablissement d’une production de profits plus importante, d’un taux de profit suffisant. On le croira donc si on n’a pas compris qu’il ne s’agit pas d’une crise dont la seule cause serait financière, due à une politique « libérale » qui aurait trop facilité la création monétaire et les revenus financiers en même temps que l’appauvrissement de la masse des salariés petits et moyens.
Or nous avons montré qu’il ne s’agissait pas d’une crise financière, mais « systémique », caractérisée par le phénomène de suraccumulation du capital (sous toutes ses formes) est de sous-consommation, dont l’unité se manifeste comme baisse du taux de profit. Sur cette base maintenant établie, il sera possible d’examiner comment tous les faux diagnostics amènent à de fausses solutions. Et a contrario, de comprendre quelles mesures essentielles, au-delà du nécessaire sauvetage immédiat du système de crédit, le capital met et mettra en œuvre pour « sortir » de la crise. De comprendre aussi quelle solution le prolétariat peut de son côté mettre en œuvre pour sortir définitivement de ces crises récurrentes.


Bonjour Tom Thomas,
Actuellement le capitalisme semble trouver un regain d’espoir, dans ce qu’il nomme le néo-chatalisme TMM théorie monétaire moderne.
Le fond de cette théorie, c’est l’Etat qui s’emprunte à lui même.
Cette théorie est tirée directement du Proudhomisme.
Qui préconnisait à son époque, où l’étalon or était la monnaie de référence, de s’en débarrasser, autrement dit d’oter la valeur à l’équivalent général, pour n’en faire qu’un simple jeton.
Depuis 2008, les banques centrales n’ont cessées de monétiser la dette des Etats, en la créditant dans le système bancaire et divers mécanismes ajustement sur les prix et de soutient par l’endettedement public.
Ce qui revient brièvement à constater que la dette est devenue un actif, et que l’on ne doit plus regarder la dette comme une catastrophe, mais plutôt comme un signe de l’activité des Etats dans l’économie.
Les leviers se portent sur la demande, quand il y a trop d’emplois pour éviter l’inflation on fait baisser l’emploi, quand il n’y en a pas assez on relève le taux d’emplois.
Mais la monnaie, n’est plus le reflet de la valeur, e qui pose un sérieux problème.
Evidemment on ne peut éviter les bulles, mais quand une bulle éclate dans un secteur particulier,cela n’effondrera pas le système capitaliste.
Mon niveau de compréhension est incomplet sur ce sujet.
j’aimerais bien avoir une analyse marxienne, de cette économie monétaire.
Merci et je lis toujours vos analyses avec chaque fois un plaisir renouvelé, surtout écrit avec clarté.
Raoul
Bonjour,
Vous trouverez des éléments de réponse à vos questions dans le dernier livre qui vient juste de sortir, voir l’article du blog à http://www.demystification.fr/blog/quoi-quil-en-coute/
Bien à vous