DE LA NECESSITE D’ETRE RADICAL
Publié par admin on Juil 7, 2013 | 0 commentaire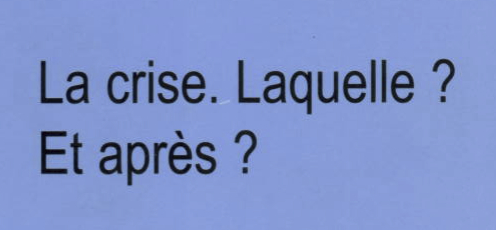
CHAPITRE 6 du livre de Tom Thomas « La crise. Laquelle? Et après? »
Etre radical, c’est aller à la racine et agir radicalement. C’est éradiquer les causes des catastrophes au lieu de ne s’en prendre qu’à ses symptômes, ses manifestations superficielles. Mais qu’est ce qu’aller à la racine de la crise? L’analyse exposée dans les cinq chapitres précédents permet maintenant de répondre à cette question.
C’est d’abord rejeter les soi-disant remèdes bourgeois qui consistent à vouloir moraliser le capitalisme financier, à le réglementer, à réguler la reproduction du capital, à accroître l’étatisation de la société. Ces remèdes ne résolvent rien. Tout au plus, ils fournissent un bref répit au capital tout en préparant les conditions d’une crise encore plus grave et au prix d’une profonde aggravation de la situation des masses populaires.
C’est ensuite comprendre que cette crise n’est pas simplement une crise financière, mais le résultat d’un blocage de la reproduction du capital, du capitalisme comme mode de production fondé sur la propriété privée des moyens de production.
C’est encore comprendre que le capitalisme est ce rapport social spécifique qui, entre autres effets, induit un développement permanent et aveugle des capacités de production et de la productivité, d’où il résulte une production croissante de richesses grâce aux applications de la science et aux machines de plus en plus puissantes et automatiques. Donc c’est comprendre aussi que la part du travail vivant dans le produit diminue sans cesse relativement à celle du travail mort accumulé dans cette machinerie, phénomène qui se développe quand le capitalisme va bien et que le capital s’accumule.
C’est enfin comprendre que s’accumulent en même temps les contradictions du système, contradictions dont la crise n’est que l’apparition soudaine, le symptôme d’une maladie qui a plus ou moins longuement incubé, le signal que ce processus de suraccumulation/sous-consommation est arrivé à un point où non seulement il y a « trop » de capital par rapport à la plus-value qu’il peut réaliser et recevoir, mais aussi que cette plus-value, qui ne peut même plus être convertie en capital additionnel, apparaît contradictoirement comme « trop » de plus-value. Or le capital ne peut exister que s’il peut assurer cette conversion, que s’il peut s’accumuler.
Il y a donc une condamnation radicale de ce mode de production dans ce fait que ce qu’il a pu apporter de positif dans le développement humain, à savoir le développement fantastique de la science et de ses applications qui a permis d’accroître formidablement la production de richesses par le moyen de machines de plus en plus efficaces, il l’a transformé en moyens de paupérisation massive, d’aliénation des individus, et de destruction de la planète. La diminution du travail contraint et répulsif que permettent les machines ne se traduit pas, pour ceux qui y sont obligés, par une vie plus libre, plus maîtrisée, plus enrichissante, mais par plus de misères, de crises et de guerres.
Cette diminution n’est pas un phénomène nouveau. Elle est constitutive du capital. Elle fait corps avec son existence même. Ses fonctionnaires n’y peuvent rien. Ils sont obligés d’agir ainsi. Mais elle a connu une accélération exponentielle depuis un peu plus d’un siècle. Marx la prévoyait déjà il y a quelques 150 ans: « Il n’y a pas le moindre doute que la tendance du capital à se rattraper (de la tendance à la baisse du taux de profit, n.d.a.) sur l’intensification systématique du travail… et à transformer chaque perfectionnement du système mécanique en un nouveau moyen d’exploitation, doit conduire à un point où une nouvelle diminution des heures de travail deviendra inévitable »115.
Si ce phénomène n’est certes pas nouveau, l’ampleur extraordinaire de la crise actuelle révèle combien il a atteint un niveau extrême et insurmontable sauf, bien entendu, à détruire dramatiquement et massivement hommes, richesses, nature et humanité. Cette situation, Marx et Engels l’ont imaginée quand ils écrivaient dans le Manifeste du Parti communiste que viendrait le moment où la bourgeoisie ne pourrait plus être nourrie par le prolétariat, ni donc celui-ci se nourrir, parce qu’elle ne pourrait plus le faire travailler suffisamment, et devrait donc « le laisser déchoir ».
C’est à ce stade sénile qu’est parvenu le capitalisme définitivement mondialisé, avec une overdose de crédit et contraint de « laisser déchoir » les prolétaires par dizaines voire centaines de millions. Mais il ne mourra qu’exécuté par la lutte révolutionnaire visant à abolir le rapport d’appropriation ainsi que les classes sociales. Il nous faut maintenant comprendre, pour en finir avec l’analyse de la crise, ce que nous révèle cette sénilité du capital quant à la possibilité de le détruire en construisant une société d’individus sociaux libres, possesseurs des moyens de la vie que l’humanité a créés et qu’ils perfectionneront à leur tour.
Nous savons qu’à force d’améliorer l’efficacité des machines, le capital diminue la quantité de travail que contient chaque marchandise, c’est-à-dire leur valeur. Or, le capital ne peut exister et se reproduire sans se nourrir de « survaleur » (plus-value), laquelle finit par décroître tant la valeur qui la contient décroît elle-même (chaque capitaliste, à force de vouloir diminuer la quantité de travail vivant payé, finit par diminuer aussi la quantité de travail vivant totale jusqu’à un point où le surtravail non payé diminue lui aussi, malgré l’augmentation du taux d’exploitation pl/Cv). Mais ce n’est pas tout. Le capital n’existe que dans les échanges entre propriétaires privés, capitaux, produisant non pour eux-mêmes mais pour les autres, pour la vente. La valeur est ce qui permet de mesurer ces échanges qui forment ensemble le procès de production capitaliste. Sous forme de prix, c’est elle qui permet de faire fonctionner « la main invisible » et anarchique du « marché » qui équilibre tant bien que mal les activités privées. Sans valeur, pas de survaleur (plus-value), pas de mesure des travaux, pas de prix, pas d’échanges, pas de répartition quelque peu équilibrée des activités entre les différentes branches, etc. Bref, sans valeur, pas de capital qui est « valeur se valorisant ».
Bien sûr, on est encore très loin d’un monde sans valeur, un monde où tout le travail humain serait d’une telle qualité qu’il serait volontaire, libre, et qu’il n’y aurait plus besoin de le compter de la sorte comme travail social moyen abstrait116. Mais ce qu’il est intéressant de noter ici, c’est cette tendance à la baisse des valeurs, et pourquoi elle se présente comme une catastrophe pour le capital et une bonne nouvelle pour le communisme.
Le mouvement des prix réels, ou même celui des prix nominaux quand l’inflation monétaire est faible117, ce qui était le cas ces vingt dernières années, reflète sur longue période celui des valeurs. Or c’est bien une tendance générale à la déflation qui s’est établie depuis une vingtaine d’années. Si on laisse de côté la hausse purement conjoncturelle des prix des produits à production limitée et longue à modifier, que produit un brusque déséquilibre de l’offre et de la demande (par exemple, la hausse spectaculaire des prix des matières premières en 2007-2008 juste avant le krach), on observe une tendance générale à la baisse des prix réels. Par exemple, les prix, même nominaux, de nombreux biens de consommation courants ont baissé en France selon l’INSEE: « En France, l’INSEE estime que le prix des équipements ménagers a baissé de 15 % depuis 1998, l’audiovisuel de 60 %; les matériels de traitement de l’informatique, y compris micro-ordinateurs, ont chuté de plus de 80 % (à qualité égale faut-il préciser) »118.
Cette baisse des prix ne tient pas seulement aux bas salaires chinois ou autres, même si cela a joué un rôle conjoncturel puissant d’accélération de la baisse. Que l’inflation hors secteur financier ait été en général faible dans les pays développés, malgré les émissions massives de crédits (de monnaies), montre d’ailleurs, a contrario, l’ampleur de la déflation des valeurs.
Mais si les marchandises n’ont plus de valeur (simple cas limite théorique de la tendance à la baisse des valeurs), alors non seulement les produits et les échanges n’ont plus de mesure, mais le capital ne peut se reproduire puisqu’il est « valeur se valorisant ». C’est une observation générale que l’on doit au génie de Marx qui écrivait: le capitalisme est « contradiction en procès, en ce qu’il s’efforce de réduire le temps de travail à un minimum, tandis que d’un autre côté, il pose le temps de travail (la valeur, n.d.a.) comme seule mesure et source de la richesse »119. Et il fut le premier à comprendre dans cette contradiction une cause de la finitude du mode de production capitaliste, en même temps qu’une condition de son abolition: « Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a cessé d’être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse nécessairement d’être sa mesure et, par suite, la valeur d’échange (et donc l’argent, le prix, n.d.a.) d’être la mesure de la valeur d’usage… Cela signifie l’écroulement de la production reposant sur la valeur d’échange (le capitalisme)… C’est le libre développement des individualités… où l’on réduit le travail nécessaire de la société jusqu’à un minimum, à quoi correspond la formation artistique, scientifique, etc., (le travail riche) des individus grâce au temps libéré et aux moyens créés pour eux tous »120.
Certes, on n’est pas encore à la fin du travail immédiat contraint, répulsif, abrutissant, qui implique sa représentation et sa mesure, ainsi que celle de la richesse qu’il produit, par la valeur121. Mais c’est de cette tendance qu’il s’agit. La crise en révèle l’avancement, l’acuité atteinte par la contradiction de vouloir mesurer la création d’une richesse d’un contenu qualitatif élevé par la quantité, de plus en plus faible, d’un travail prolétaire de plus en plus pauvre. Alors que cette richesse dépend maintenant «… bien plutôt du niveau général de la science et du progrès de la technologie, autrement dit, de l’application de cette science à la production »122. Laquelle science est une activité intellectuelle aléatoire et qualitative qui ne peut se réduire à une quantité de travail social simple et abstrait (à une valeur d’échange).
C’est finalement le niveau extrême atteint par cette contradiction, qui est aussi celui atteint par la productivité de la production planétaire, que révèle cette crise. Niveau à partir duquel il devient difficile au capital d’augmenter la quantité de travail prolétaire qu’il peut employer, et difficile aussi d’accroître substantiellement – même s’il s’y emploie avec la plus grande et brutale énergie – le taux d’exploitation de celle qu’il emploie. Ce sont là les sources fondamentales de la plus-value qui se tarissent petit à petit, ce que manifestent les pertes gigantesques de capitaux et l’effondrement des profits qui se produisent avec la crise.
Certes, le capital espère trouver de nouveaux « gisements de croissance ». Par exemple, voilà toute la bourgeoisie qui rejoint sa nouvelle avant- garde verte. Elle ne jure plus que par le vert, cette nouvelle forme de l’idéologie du « bon capitalisme ». Le capitalisme vert permettrait de relancer l’accumulation du capital grâce à tous les travaux de mise aux normes écologiques: nouvelles voitures, nouveaux bâtiments, nouvelle agriculture, nouvelles industries, et cerise sur le gâteau, nouveau personnel politique vert garanti « propre » et dévoué à l’intérêt général. Cette promesse d’un capitalisme vert, moral, durable et équitable n’est qu’une escroquerie. Le capital n’existe pas sans valorisation et accumulation. Une accumulation capitaliste qui ne ruinerait pas les prolétaires et la planète est une contradiction absolue dans les termes. Au mieux, ou plutôt au pire, le capitalisme vert reviendrait à faire payer les surcoûts de toutes ces « nouveautés » au peuple, via les dépenses de l’Etat (ce qui est, par exemple, déjà le cas avec l’électricité verte achetée fort cher aux capitalistes, et générant donc la hausse des prix pour les consommateurs). Car évidemment, il n’est pas question d’avoir le capitalisme vert sans profits verts. Que les hommes maîtrisent et gèrent intelligemment leurs rapports avec la nature, cela passe nécessairement par un autre mode de production qui leur serait soumis au lieu qu’ils lui soient soumis, par une société d’individus sociaux, non aliénés.
Devant toutes ces impasses, il ne reste au capitalisme que le moyen des destructions (guerres comprises) pour pouvoir réemployer et exploiter les prolétaires (ceux qui y survivraient).
Les prolétaires n’ont, eux, d’avenir désirable que dans l’abolition de leur condition de prolétaires, de « déchus », d’incarcérés, de massacrés. Pour cela, il leur faut parvenir, ce qui n’est possible que par un procès révolutionnaire long et complexe, à se saisir de cette situation où le temps du travail contraint, qui est le leur, a baissé – et peut objectivement baisser encore bien plus – tandis que la production augmentait, pour achever, mais à leur façon, dans le but de se supprimer comme prolétaires, ce mouvement que le capital ne peut pas achever, mais doit au contraire stopper et contrarier123 par le moyen de crises toujours plus destructrices.
A leur façon? C’est d’abord d’avoir à lutter contre la baisse de leurs revenus et de leur niveau de vie, baisse qui va fortement s’accentuer ces prochaines années, tant par la précarisation accrue du travail que par la hausse probable de l’inflation. En effet, celle-ci, récurrente dans le secteur des actifs financiers, pourrait aussi se produire dans le secteur des marchandises. Car, face à la tendance fondamentale à la déflation de leurs valeurs, il y a la débauche inouïe des émissions monétaires. Celle-ci poussera à la hausse des prix nominaux, d’autant plus que les hausses de productivité stagnent ou faiblissent, que la concentration oligopolistique et le protectionnisme s’accroissent, que la liquidation des stocks s’achève et que des limites sont plus ou moins atteintes dans les bas salaires chinois (et autres pays « low costs »).
De plus, les Etats ont tout intérêt à l’inflation, indispensable pour abaisser le montant de leurs dettes gigantesques car la hausse des impôts ne saurait suffire à les honorer. Grâce à l’inflation, ils les rembourseront en « monnaie de singe » ou ils rachèteront à bas prix, la valeur des titres de la dette déjà émis s’écroulant avec la hausse des taux d’intérêt qu’entraînerait inévitablement l’inflation.
L’inflation sera une cause supplémentaire de ruine pour les salariés, les chômeurs, les retraités. Mais elle se retournera aussi rapidement contre le capital, puisqu’elle a aussi pour effet, du fait de la hausse des taux d’intérêts, de ruiner l’épargne, la valeur du titre financier, et donc finalement le crédit dont nous avons souligné le rôle essentiel dans le capitalisme financier. C’est pourquoi les financiers, qui d’un côté adjurent l’Etat de les inonder de liquidités, s’inquiètent fort de l’autre de l’inflation qui pourrait les ruiner, eux et le système financier.
En réalité, déflation ou inflation monétaires sont toutes deux néfastes à la reproduction du capital. Et cela d’autant plus que le rôle du crédit y est devenu important. Restreindre les liquidités au niveau de celui de la valeur des marchandises en circulation conserverait la valeur de la monnaie mais ferait immédiatement s’effondrer un système financier asséché car croulant sous la masse de capital fictif, de titres sans valeur. Les augmenter massivement pour sauver ce système aujourd’hui ne fait que retarder et aggraver sa chute demain. Il n’y a pas de solution monétaire à la crise, parce qu’elle n’est pas monétaire, parce que ce n’est pas l’argent en plus ou en moins qui produit le profit dont se nourrit le capital. La déflation traduit finalement la tendance fondamentale à la baisse des valeurs, donc la dévalorisation du capital lui-même. Mais démultiplier la masse des signes monétaires alors que celle des valeurs en circulation stagne ou baisse avec la crise, ce n’est rien que créer du papier, de la monnaie dévalorisée, de la richesse fictive.
Mais revenons à la lutte pour le revenu et le pouvoir d’achat. Il faut bien comprendre ce point essentiel qu’elle ne pourra pas être déconnectée de cette réalité qu’est la baisse de la quantité de travail prolétaire nécessaire. Nous savons comment la bourgeoisie tente de faire face à sa façon à cette diminution de la quantité de travail: elle développe le travail précarisé et baisse le coût salarial, poursuivant par là son objectif permanent d’accroissement de la plus-value.
Les prolétaires doivent refuser l’escroquerie qui consiste à essayer de leur faire croire que s’ils acceptaient de s’adapter « au monde moderne » (la soi-disant « rupture » sarkozienne), comme si ce monde était objectivement le seul possible, s’ils acceptaient aujourd’hui de faire les sacrifices « nécessaires » – pendant que la haute bourgeoisie et les politiciens continuent de se gaver – alors il y aurait une nouvelle croissance, et leur sort s’améliorerait (ils en auraient des miettes). Ceux qui avaient accepté ces dernières années une dégradation de leurs conditions de travail contre la promesse de sauver leur entreprise et leur emploi en savent quelque chose. Ils sont souvent aujourd’hui parmi les premiers licenciés.
Mais plus important encore est de comprendre que toute tentative de s’accrocher à l’ancien rapport de production dit fordiste (ou compromis fordiste), caractérisé selon ses laudateurs, les régulateurs, comme fondé sur un partage des gains de productivité entre le capital (pour lui beaucoup) et le travail (pour lui beaucoup moins), permettant à la fois la valorisation et l’accumulation du premier et l’élévation du pouvoir d’achat du second, est aussi vouée à l’échec. Les syndicats qui cogéraient ce compromis avec le patronat recherchaient avec eux la croissance à tout prix, et notamment, au prix de l’aggravation des conditions de travail de l’OS. Pour eux, la croissance était la panacée censée générer l’emploi pour tous et une relative hausse du niveau de vie. Nous ne reviendrons pas ici sur la réalité, beaucoup moins idyllique (notamment pour les OS et les immigrés, souvent les mêmes d’ailleurs), de cette croissance. Bornons nous à constater que le « compromis fordiste » est définitivement obsolète depuis plus de vingt ans, et que l’ancien mouvement ouvrier (sous l’égide, en France, du couple PCF-CGT), qui ne cherchait pas à supprimer la condition de prolétaire mais seulement à améliorer un peu son sort matériel tout en conservant la vieille division capitaliste du travail dirigeants/exécutants, est lui aussi mort depuis longtemps. Reste le nouveau rapport de production précarisé, l’hyper-taylorisation du travail et la baisse du pouvoir d’achat. Reste un « nouveau » mouvement prolétarien à surgir. Nouveau en ce sens qu’il n’a rien à espérer pour les prolétaires du côté de la fameuse croissance. Nouveau, donc, parce qu’il ne pourra pas séparer la question de l’amélioration, ou pas, du niveau de vie prolétaire de celle de la diminution du temps de travail nécessaire, du temps de « l’emploi ». Car soit il reste soumis à l’idéologie réformiste et tente de négocier le rapport de production précarisé, et donc finalement accepte de travailler moins pour gagner beaucoup moins. Soit il lutte frontalement contre ce rapport en reliant le « travailler moins » à « travailler tous » (partage du travail contraint) afin de dégager du temps libre pour « travailler autrement », c’est-à-dire s’approprier les conditions d’un travail riche, libre. Ce qui nécessite d’engager un processus révolutionnaire passant, tout d’abord, par le renversement de l’Etat (de la dictature bourgeoise).
L’Etat devenant totalitaire est la cible immédiate de la lutte. A partir du moment où le prolétaire tend à devenir un « working poor » de plus en plus « poor », un sans travail fixe souvent même sans domicile fixe, et où une part grandissante de son revenu de survie lui est payé par l’Etat, il en résulte que sa lutte tend à ne plus se focaliser sur le problème d’une hausse de salaire à arracher à tel ou tel capitaliste particulier, mais sur le problème d’une hausse de son revenu à arracher à l’Etat, « le » capitaliste global. Il n’y a pas assez de travail? Certes, et finalement tant mieux car il y a aussi beaucoup de richesses!
Cela rappelle toutes les thèses des années 90 sur le thème d’un « revenu à vie pour tous indépendant du travail » type allocation universelle (cf. les différentes propositions à l’époque des G. Aznar, A. Gorz, D. Meda, A. Lipietz, etc.), que j’avais critiquées absolument124 en ce que, prétendant résoudre cette question dans le cadre d’un « bon capitalisme », elles ne pouvaient que soit rester des utopies, soit aboutir concrètement à des résultats dérisoires, ce que l’on a vu avec le RMI français. Ces élucubrations ayant ainsi été vite et justement enterrées, il convient maintenant de reprendre cette question de façon plus réaliste.
Il faut un revenu de partage des richesses produites (essentiellement par les machines) en fonction des besoins de chacun et du partage de ce qui reste de travail contraint (ou restera une fois supprimés gaspillages et productions socialement nuisibles ou inutiles). Or il ne peut y avoir un partage de ce qui est produit s’il n’y en a pas de la possession de ce qui les produit, des moyens de production. C’est toujours ceux qui possèdent ces moyens, les maîtrisent, qui décident aussi, finalement, de l’affectation du produit. Ceci quelle que soit la forme plus ou moins « démocratique » sous laquelle se fait éventuellement cette affectation. Car la démocratie reste formelle tant que les conditions de la production de la vie et de la société appartiennent à une classe particulière.
Pas de lutte efficace pour le niveau de vie qui ne s’affronte à l’Etat jusqu’à le renverser, et pour renverser avec lui le rapport de production capitaliste dont il est plus que jamais le grand organisateur. Et qu’est-ce que renverser ce rapport, aujourd’hui le rapport précarisé? C’est se mettre dans le sens du mouvement réel, celui de la diminution du travail contraint, prolétaire – mouvement que la bourgeoisie bloque au prix de crises de plus en plus destructrices – mais pour le réaliser jusqu’au bout, jusqu’à la fin de la domination du travail contraint sur la vie prolétaire (à vrai dire d’ailleurs, c’est toute la vie du prolétaire qui est contrainte, et pas seulement dominée, du moins tant qu’il n’exerce pas sa liberté par une activité révolutionnaire). Jusqu’au bout, c’est donc jusqu’à la fin de l’ultime grande division du travail (i.e., de la propriété) capitaliste entre puissances intellectuelles et managériales d’un côté, et masse des exécutants dépouillés de l’autre125. Ce qui est la fin de la propriété privée des conditions de la production de la vie, et l’abolition des classes.
Pour entamer ce processus – qui exige le renversement de l’Etat – le mot d’ordre n’est donc pas croissance à n’importe quel prix, emploi pour n’importe quel prix, étatisation renforcée au prix d’une dictature renforcée. Il est partage du travail contraint et partage des richesses selon les besoins. Mais un tel partage ne supprimerait pas encore la condition de prolétaire, pas plus que celle du maître des conditions de la production qui lui fait encore face. De ce fait, il ne saurait d’ailleurs pas perdurer longtemps. C’est pourquoi, la lutte devra se poursuivre pour que, s’appuyant sur le temps libre procuré par la baisse drastique du temps de travail contraint, les prolétaires s’en servent comme base matérielle pour s’approprier jusqu’aux conditions intellectuelles de la maîtrise de la production et de la société, et ainsi pour diriger leur propre développement d’individus, d’individus sociaux parce que s’enrichissant les uns des autres de leurs qualités, sans compter égoïstement et âprement.
Evoqué ci-dessus, le « nouveau » mouvement ouvrier révolutionnaire, qui reste à construire dans sa forme comme dans son contenu dans le cours des prochaines luttes qui s’annoncent devoir être radicales, sans renier les exploits de ses prédécesseurs, sans négliger non plus les leçons critiques à en tirer, met sur son drapeau le vieux mot d’ordre du Manifeste du PC qui reprend un sérieux coup de jeune: abolition du salariat, abolition du prolétariat par la révolution politique et sociale.
« Il ne peut pas s’agir pour nous de transformer la propriété privée mais seulement de l’anéantir, il ne s’agit pas d’arranger les contradictions de classes, mais de supprimer les classes, il ne s’agit pas d’améliorer la société existante mais d’en fonder une nouvelle »126.
Ce que la crise révèle, c’est que la situation contient d’excellents moyens pour y parvenir. Car ce qui est néfaste au capital, cette diminution du travail prolétaire dont il se nourrit tel un vampire, qui est la base de son existence, est excellent pour les prolétaires au sens que, puisque c’est de leur disparition dont il s’agit, ils peuvent la réaliser à leur façon plutôt que de se laisser « déchoir » au plus bas.

