DES FAUX DIAGNOSTICS AUX FAUSSES SOLUTIONS
Publié par admin on Avr 8, 2013 | 0 commentaire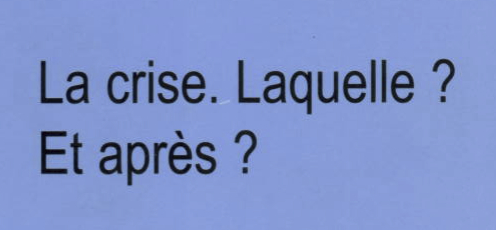
CHAPITRE 4 du livre de Tom Thomas « La crise. Laquelle? Et après? »
Tous les économistes, ou peu s’en faut, ont trouvé la cause de la crise dans l’hypertrophie du crédit, du capital et des revenus financiers. Pour eux, la solution consiste donc à réguler l’expansion de ce capital financier par des mesures qui permettraient aux Etats de contrôler l’émission monétaire en restreignant ou en augmentant le crédit.
Ce raisonnement implique évidemment qu’on croit ou qu’on veut faire croire que cette hypertrophie du capital financier est seulement due à une mauvaise politique, dite libérale. On préconise donc une autre politique plus étatique dont on pense ou feint de penser qu’elle pourrait résoudre le problème et remettre le capitalisme sur les (prétendus) bons rails de la « croissance ». Il n’y aurait donc pas à procéder à une remise en cause du capitalisme, mais seulement à constater que « les marchés n’autorégulent pas l’économie », qu’il faut y ajouter un pilotage par l’Etat qui les oriente et les réglemente, les protège contre leurs propres excès et aveuglements, voire, comble de la propagande, les « moralise ».
Mais nous savons qu’il ne s’agit ni d’une crise financière, ni d’une crise due à une mauvaise politique. Il s’agit d’une crise résultant du développement « normal », inéluctable, du mode de production capitaliste et de ses contradictions. La bourgeoisie ne peut modifier ce développement que marginalement, l’accélérer ou le freiner mais pas lui faire suivre un cours très différent. Elle n’est pas une classe d’individus libres mais, comme le disait Marx, une classe de « fonctionnaires du capital ».
Ainsi réguler, rééquilibrer, proportionner, sont des propositions que les experts bourgeois formulent toujours en temps de crise. En fait, ces propositions consistent simplement à faire ce que la crise a pour fonction de faire, et qu’elle oblige les fonctionnaires du capital à faire. En effet, la crise est le moment où le capital s’efforce de réunifier tout ce qu’il a auparavant séparé jusqu’à créer des disproportions pour lui insupportables: le « trop » de moyens de production par rapport aux besoins solvables, le « trop » de capital fictif par rapport au capital productif de pl, le « trop » de monnaie par rapport aux valeurs réelles en circulation, le « trop » de profits financiers par rapport au pas assez de salaires, etc. Ces disproportions sont réelles et se constatent aisément. Mais il ne s’agit que de conséquences, de phénomènes quantitatifs dont les causes sont sociales et qualitatives. Dans le mode de production capitaliste, tout n’apparaît que comme marchandises et valeurs, donc quantités. Les problèmes ne sont donc vus par ses fonctionnaires que comme des quantités, de sorte qu’ils se disputent sur les « trop » et les « pas assez ». C’est pourquoi la solution leur paraît simple. Ce n’est qu’une question de « régulation » ou de planification, un problème que des experts peuvent résoudre par des calculs. Ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu’à la base de tous ces rapports entre quantités, il y a des rapports sociaux de production, une division sociale du travail, une propriété privée des moyens de production, le concret des hommes et des rapports humains historiques, le concret de la production de leur vie et d’eux-mêmes: un concret en tout point éminemment qualitatif. Qu’ils le savent ou non n’a d’ailleurs guère d’importance. Sous couvert de régulation, d’équilibre, « d’ordre juste » et de réforme, c’est bien sur ces rapports sociaux que la bourgeoisie agira, sera néanmoins obligée d’agir afin que la production de plus-value et le taux de profit soient augmentés.
Bref, ce que la bourgeoisie est et sera obligée de faire ne découle pas d’un choix politique totalement libre mais d’un choix politique répondant le plus judicieusement possible aux lois de la reproduction du capital et de la survie de la société capitaliste59. Cela ne découle donc même pas en premier lieu de son avidité, ni de son cynisme, ni de sa cruauté, même s’il faut bien admettre qu’elle n’en est pas exempte, et que ces qualités accentuent les désastres.
Dans ce chapitre, nous allons examiner les deux séries de mesures qui, aujourd’hui, font l’objet du plus grand battage médiatique et qui sont présentées comme solutions permettant de sortir de la crise. La première propose une relance par l’offre (de crédits et de produits); la seconde par la demande ou, si l’on préfère, par la consommation. Puis, ayant montré qu’elles ne peuvent ni l’une ni l’autre permettre à elles seules de relancer un procès de reproduction du capital, nous examinerons au chapitre 5 les vraies solutions alternatives, bourgeoise et prolétarienne, qui s’attaquent vraiment au cœur du problème, c’est-à-dire aux rapports sociaux de production et d’appropriation, mais qui s’y attaquent de façon opposée.
4.1 Les mesures de sauvetage par la relance du crédit
Les mesures de sauvetage du système financier par l’Etat ont été massives et spectaculaires. Mises en œuvre par le Trésor Public et la Banque Centrale, elles auraient soi-disant pour résultat de relancer le crédit, et par là, les affaires et la croissance. Elles sont, bien sûr, accompagnées de promesse de réglementation, de contrôle et de moralisation du système financier, destinées à justifier les milliers de milliards d’euros et de dollars qui y sont déversés. Il s’y ajoute un soutien financier massif aux grandes entreprises en difficultés notamment dans le secteur automobile afin de les restructurer et d’y retrouver une production profitable.
Ces mesures de sauvetage du système financier consistent pour l’essentiel à ce que les Etats lui fournissent des liquidités lui permettant de ne pas s’écrouler sous le poids du gigantesque monceau d’impayés, et d’échapper à la faillite généralisée. Les Banques Centrales abaissent les taux d’intérêt de l’argent qu’elles prêtent, allant jusqu’à ce que ces taux soient négatifs en termes réels, c’est-à-dire en dessous du taux d’inflation. Elles prennent, en soi-disant garantie de leurs prêts, des créances « toxiques » quasi irrécouvrables dont se débarrassent ainsi les banques. Mais cela ne suffit pas, elles doivent aussi acheter les titres des dettes du Trésor Public, car celles-ci gonflent tellement que ces titres ne trouvent pas tous preneurs, même aux USA. Tout cela est de la création monétaire à grande échelle qui ne va pas ralentir de sitôt puisque les dettes publiques, à tous les échelons administratifs, ne cessent de gonfler davantage comme si les milliers de milliards de dollars déjà déversés par les divers appareils d’Etat l’avaient été dans un tonneau des Danaïdes. Petit à petit, les Trésors Publics sont obligés d’aller jusqu’à prendre directement à leur charge un monceau de dettes de certaines banques en les nationalisant en tout ou partie. Ceci, faut-il le rappeler, ne change d’ailleurs quasiment rien au système capitaliste. Or les experts doivent constater dépités que ces milliers de milliards de liquidités dont ils annonçaient qu’elles permettraient de renflouer les institutions financières et de relancer le crédit qui à son tour relancerait les affaires, la production et la croissance, n’aboutissent pas à ce résultat. Pourquoi?
Observons d’abord qu’il s’agit là de mesures indispensables à la survie du système financier, et donc du système capitaliste lui-même, puisque le crédit, donc aussi les bourses, les banques et les autres organismes de concentration et de placement du capital argent, lui sont indispensables. Quand il y a une voie d’eau, il faut d’abord la colmater avant de pouvoir faire repartir le navire.
Mais justement l’effet de ces milliards déversés dans le système financier est seulement de maintenir à flot le navire en panne. Ni le crédit, ni la croissance ne redémarrent pour autant. Les raisons en sont bien connues. Il y a tout d’abord le phénomène dit de « trappe à liquidités »: criblées de dettes, les banques utilisent l’argent reçu de l’Etat pour les rembourser, ou pour combler le trou de leurs propres créances irrécouvrables. Même quand elles le peuvent, elles n’osent plus prêter vu que le risque d’insolvabilité s’aggrave tant que la crise se généralise et s’approfondit et tant que le monceau de créances toxiques n’aura pas été purgé. Ensuite, il n’y a pas non plus beaucoup d’emprunteurs dans cette situation, à part l’Etat lui-même qui a l’avantage d’être réputé toujours solvable. En effet, les ménages sont surendettés, les entreprises aussi et d’autant plus depuis que leurs ventes s’écroulent et que les machines sont sous-utilisées, que la production est en berne60. « La politique de baisse des taux d’intérêt trouve ses limites: ce n’est pas parce que l’argent est bon marché que les entreprises et les ménages emprunteront, mais parce qu’ils ont des projets viables (i.e. profitables). On retrouve le phénomène bien connu de « trappe à liquidité »… les banques centrales ont beau créer des liquidités jusqu’à plus soif, cet argent ne parvient pas à s’incarner dans des investissements »61.
La conséquence de tout cela est que ces injections massives de liquidités par les Etats:
– maintiennent à flot le système financier – dont l’écroulement total serait catastrophique pour le capital – au moyen de la transformation de créances privées irrécouvrables (dettes privées insolvables) en titres de la dette publique (créances privées supposées recouvrables);
– ne produisent pas à elles seules de reprise de l’investissement productif et de la croissance (i.e. de l’accumulation du capital).
A cela, il faut ajouter une autre conséquence. Par ces mesures financières, la bourgeoisie arrive à un paradoxe: elle a proclamé que l’overdose de crédit était la cause de la crise et voilà qu’elle est en train d’en créer tant qu’elle peut! Elle avoue ainsi, malgré elle, qu’elle ne peut calmer le drogué en crise de manque qu’en lui en redonnant. Jusqu’à évidemment provoquer une nouvelle crise. Et on voit bien effectivement gonfler rapidement une nouvelle bulle: celle des titres des dettes publiques émis massivement. Ils trouvent facilement preneur du fait même que la débâcle financière pousse les propriétaires de l’argent au « flight to quality », à l’achat de titres censés conserver la valeur, notamment les bons du trésor US. Mais ceci n’est nullement garanti. Déjà la Chine et d’autres annoncent qu’il convient de se méfier du dollar.
Les Etats sont supposés ne jamais tomber en faillite! Quelle erreur! Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises. Leur faillite peut d’ailleurs prendre plusieurs formes plus ou moins subtiles: radicale avec le moratoire qui annule brutalement tout ou partie des dettes; plus étalée avec l’inflation monétaire qui permet de rembourser les dettes en « monnaie de singe »; plus masquée avec les hausses d’impôts qu’on fait passer comme justifiées par des besoins sociaux alors qu’ils remboursent la dette publique par une ponction sur les revenus du peuple. Bien sûr, tous ces moyens ne sont pas exclusifs les uns des autres. Il est même certain qu’ils seront tous utilisés compte tenu des montants astronomiques que devraient atteindre les dettes publiques dans le monde. Tous, y compris le moratoire qui pourrait peut-être même concerner les plus puissants, tels les USA. Inimaginable? Nullement! Certains experts commencent à l’envisager sérieusement. Ainsi on peut lire dans La Tribune du 15 mai dernier cette déclaration: « Les USA, too big to fail?… La réalité, c’est que les USA ne pourront faire face à leurs engagements (non seulement « une dette gigantesque », mais « des garanties sur tout et n’importe quoi » précise l’auteur). Ils devront dévaluer le dollar, mais cela ne suffira pas. Ils devront également renégocier leur dette ».
Certes, les dirigeants du capitalisme passent sous silence ce paradoxe. Ils nous assurent, au contraire, qu’ils ont bien compris la leçon des conséquences d’une overdose de crédits et qu’à l’avenir cela ne se reproduira plus. La finance sera réglementée et contrôlée (oublions le « moralisée » sarkozyste qui fait rire jusqu’au moins cynique des financiers). Mais leurs actes témoignent du contraire: ils émettent des titres et des liquidités à tout va.
En outre, examinons un instant cette idée de contrôle du crédit. Les experts se flattent de pouvoir trouver un équilibre entre le « trop » de crédit qui produit des bulles et des krachs, et le « pas assez » qui entrave la croissance. C’est tout le dilemme des politiques fondées sur l’illusion monétaire qui est de croire que c’est la quantité d’argent disponible qui détermine le niveau des échanges et de la production alors que c’est l’inverse. En réalité, ce sont les capitalistes qui en décident en fonction des profits qu’ils espèrent pouvoir obtenir. Et comme c’est l’Etat qui émet la monnaie officielle, il y a en outre l’illusion politique en vertu de laquelle l’Etat pourrait contrôler à sa guise l’activité économique en ouvrant plus ou moins les vannes du crédit.
Certes, en proposant des crédits à des taux très bas, l’Etat abaisse les frais financiers des entreprises et peut ainsi améliorer le taux de profit. Du moins si les conditions de cette amélioration existent d’abord dans les composantes internes du taux de profit (composition organique, taux d’exploitation), et notamment dans la production et la réalisation de la pl. Ce qui justement est loin d’être le cas, ainsi que la crise le révèle. On a déjà vu dans de nombreux cas (le Japon des années 1990-2000 par exemple) que même un taux d’intérêt proche de zéro n’entraînait aucune reprise de l’activité. Ce n’est qu’au moment où le taux de profit se relève et que le procès de valorisation du capital reprend vigueur qu’une baisse des taux du crédit peut être un stimulant efficace de cette reprise.
La question n’est pas que les banques centrales ne disposent pas de moyens techniques de contrôle du crédit. Elles disposent notamment des taux de refinancement du niveau des dépôts obligatoires, de celui du ratio des fonds propres par rapport aux prêts, etc. Le problème ne réside pas non plus dans l’impossibilité d’améliorer ces moyens. En effet, il est possible de rendre plus transparents les circuits opaques de la circulation de l’argent, de supprimer les paradis fiscaux et les cascades de filiales offshore, de réglementer strictement et de limiter les techniques de titrisation qui permettent aux banques de se refinancer hors contrôle des banques centrales, d’ouvrir totalement tous les comptes des sociétés financières cotées ou non, de taxer sévèrement les opérations spéculatives, etc. Mais imposer tout cela sans toucher aux bases mêmes de la propriété capitaliste n’est que rêves véhiculés par tous les moralisateurs du capitalisme et autres utopistes62. C’est que, répétons le, c’est le niveau de développement des productions et des échanges, les perspectives de profits futurs, le taux d’accumulation du capital qui décident de la progression ou de la régression des crédits, et à partir de là, de l’activité des marchés financiers, les spéculations y étant inéluctablement inclues63. Que les affaires marchent, et les banques centrales ne peuvent pas empêcher que les investisseurs enthousiastes investissent sans trop se soucier d’elles. D’autant plus que tout le monde s’en félicite, de sorte qu’on ne les laisserait pas casser un si beau mouvement! « Qui s’est plaint de l’expansion permise par l’argent facile ces 15 dernières années? » observe l’éditorialiste de La Tribune le 27 octobre 2008. Et quand les affaires ne marchent pas, nous venons de voir que les Etats ne parviennent pas à les relancer par la simple émission de liquidités.
4.2 Les mesures de relance par la consommation
Ces mesures, dites parfois mesures keynésiennes, visent à relancer la croissance de la production par une augmentation de la consommation. Laquelle serait obtenue, non seulement par le déficit budgétaire afin d’augmenter les commandes et dépenses de l’Etat, mais aussi, ce qui donne une coloration « de gauche » aux mesures en question, par une nouvelle répartition entre profits et salaires, répartition s’opérant en faveur de ces derniers.
Ceux qui préconisent ces mesures savent que le sauvetage du système financier est indispensable pour sauver la société actuelle. Ils l’approuvent, mais ils le jugent insuffisant pour relancer la croissance. Pour cela, disent-ils, il faut aussi relancer la consommation de masse. Mais il ne leur apparaît pas souhaitable de le faire par un surcroît de crédit dont l’excès a, selon eux aussi, causé la crise. De toute façon, ajoutent-ils, un surcroît de crédit n’apporterait rien tant les ménages sont déjà surendettés. Par conséquent, la seule solution réside dans l’augmentation des salaires, directs et indirects.
Voilà une solution qui paraît « de gauche » puisque favorable aux salariés. Le constat sur lequel ces experts la fondent pourrait même sembler marxiste puisqu’il affirme la sous-consommation des masses comme cause ultime de la crise. Mais en réalité, l’analyse diverge absolument de l’analyse marxiste en ce qu’elle ne comprend pas cette sous-consommation comme une conséquence inéluctable de l’accumulation du capital, mais comme étant due à une politique délibérée qualifiée de libéralisme64 et menée à partir des années 1980 par les gouvernements des Reagan, Thatcher, Mitterrand et autres, qui n’auraient gouverné que dans les intérêts du seul capital financier, au détriment de ceux du capital en général, le fameux soi-disant « intérêt général ». Une autre politique capitaliste servant l’intérêt général serait donc possible. La politique libérale, ayant systématiquement choisi de sacrifier les salaires (et d’y substituer le crédit, enflant par là les bulles financières) afin d’augmenter les rentes financières, devrait être abandonnée et remplacée par une autre. Celle-ci rééquilibrerait le partage de la « valeur ajoutée » (salaires + profits) en faveur des salaires, donc de la consommation, ce qui, selon eux, relancerait la production.
Cette analyse des « régulateurs » repose sur une réalité incontestable: l’augmentation considérable au cours des trente dernières années de l’écart dans la répartition de la richesse produite entre d’une part, les revenus financiers et les hautes rémunérations des couches supérieures, y compris celles parasitaires des politiciens, des sportifs, des vedettes médiatiques diverses, et d’autre part, la masse des travailleurs. La paupérisation relative des prolétaires, entre autre, s’est dans l’ensemble profondément accentuée, au point d’aboutir à des situations de plus en plus nombreuses de paupérisation absolue (comme celle des RMIstes et autres SDF en France, par exemple).
Mais observons d’abord que cette réalité n’est pas tant le résultat d’un choix politique délibéré de la bourgeoisie, qui se nommerait libéralisme, mondialisation, dictature du capital financier, que celui de la nécessité où elle se trouvait de mettre en œuvre cette politique là. Elle a conduit d’ailleurs cette politique là avec d’abord un succès certain, une phase de vive croissance mondiale de la production, de l’emploi, des profits, et même une amélioration du pouvoir d’achat des salariés. Ce relatif succès était dû au fait que ces mesures agissaient comme contre-tendances aux difficultés croissantes que rencontrait le procès de valorisation–reproduction-accumulation du capital dans le cadre des rapports sociaux du « compromis fordiste ». Mais ces difficultés se sont accumulées et ont atteint un point culminant avec les grandes révoltes ouvrières de mai-juin 68 en France et les crises dites des deux « chocs pétroliers » des années 70. Et la mise en œuvre de ces contre-tendances n’a finalement abouti qu’à porter les contradictions du procès d’accumulation à un niveau d’antagonisme plus élevé. En retardant l’éclatement de la crise, elle l’a aussi rendue plus aiguë et plus massive comme nous l’avons observé précédemment.
Certes, la bourgeoisie est bien responsable et coupable d’avoir mené cette politique libérale dont elle était la grande bénéficiaire. Mais ce sont les conditions et nécessités de la reproduction du capital qui la lui ont dictée. Et nous verrons ultérieurement que la politique « étatiste » qu’elle mène maintenant pour tenter de sortir de la crise n’est nullement l’inverse du libéralisme. Elle est, au contraire, son prolongement et son renforcement par la mobilisation accrue de la puissance collective de la classe bourgeoise, l’Etat. Cette affirmation selon laquelle la bourgeoisie n’est pas une classe libre65 et selon laquelle elle n’a pas de choix, sauf dans d’étroites limites qui se rétrécissent encore plus en temps de crise, se trouve bien illustrée par cette proposition d’un partage de la valeur ajoutée qui soit plus favorable aux salariés comme moyen de relancer l’accumulation capitaliste. En effet: 1°) aucune fraction politique du capitalisme, droite ou gauche, ne peut faire ce choix dans la situation actuelle; 2°) si la lutte des prolétaires le leur imposait néanmoins, cela ne serait de toute façon pas un moyen de relancer le procès d’accumulation du capital. Bien au contraire. L’unité fondamentale des politiques dites de droite et de gauche apparaît ici très clairement. C’est d’ailleurs la gauche qui, après 1983 en France, a la première développé à grande échelle la politique libérale.
Observons maintenant que cette notion, utilisée par les économistes, de valeur ajoutée (les salaires + les profits) dont un meilleur partage permettrait de réguler l’accumulation capitaliste est fort ambiguë. Son ambiguïté tient d’abord au fait qu’elle revêt divers sens suivant ceux qui l’utilisent. Le fisc, par exemple, n’en a pas la même définition. Elle tient aussi au fait que la notion de profits telle que la saisissent les comptabilités et les statistiques ignore cette part de la plus-value qui va à toutes les fonctions de la haute bourgeoisie (ainsi qu’aux couches parasitaires), ce qui minore considérablement cette valeur ajoutée qui serait à partager. Elle tient ensuite au fait qu’on ne sait pas comment pourrait se faire ce partage. Selon quels critères? Globalement? Entreprise par entreprise en fonction de leurs caractéristiques propres? Nul ne peut le dire. Elle tient enfin et surtout au fait qu’elle sous-entend que la richesse produite serait le fruit d’une association entre des capitalistes qui apportent les moyens de production et des travailleurs qui apportent la force de travail, chacun devant être rémunéré en fonction de son apport. Or on le sait, il n’y a pas association mais antagonisme, car les moyens de production ne sont que du travail passé, approprié par les capitalistes, moyens qui, entre leurs mains, s’opposent aux ouvriers, les dominent et les écrasent. Toute la richesse n’est que le produit du travail et de la nature qui est à tous. Il ne s’agit donc pas de partager cette valeur ajoutée. Ce serait d’ailleurs reconnaître cette appropriation spoliatrice. D’ailleurs, le capitalisme lui-même impose tout autre chose: la loi du profit maximum et croissant avec l’accumulation. Les travailleurs doivent donc s’approprier toute cette valeur ajoutée, collectivement et individuellement. Cette affirmation ne remet nullement en doute la nécessité de la lutte pour de meilleurs salaires, directs et indirects, d’autant plus d’actualité que la situation matérielle des prolétaires s’aggrave considérablement avec la crise. Mais elle en redit les limites, et notamment celle-ci: qu’elle ne remet pas en cause le rapport d’appropriation capitaliste, le capitalisme. Or, tant qu’il existera, il soumettra toujours la lutte salariale aux exigences de sa reproduction dont une des conséquences inéluctables est cet écart croissant dans le partage de la richesse. Et quand crise il y a, comme aujourd’hui, toute hausse des salaires qui pourrait être momentanément obtenue sera combattue avec acharnement et intransigeance66 par la bourgeoisie étant donné l’impérieuse nécessité dans laquelle elle se trouve de redresser les profits. La lutte de classe doit alors s’élever à un tout autre niveau qui, si elle y parvient, affirmera des objectifs révolutionnaires beaucoup plus vastes et radicaux que la lutte salariale: la suppression du salariat.
Ceci étant dit, revenons-en au constat, bien réel, que la part de richesse produite revenant au capital n’a cessé d’augmenter par rapport à celle revenant aux simples travailleurs. Aux yeux des régulateurs, cela paraît une erreur, le fruit d’un mauvais et injuste choix politique. Certes, cela peut être dit des revenus pharaoniques que s’accordent en toute légalité quelques dizaines de milliers de hauts dirigeants capitalistes et de stars diverses. Revenus tellement scandaleux qu’ils focalisent l’attention et permettent de justifier du caractère anormal et corrigible de cet écart. Pourtant, mis à part le caractère scandaleusement « excessif » de ces revenus, il n’y a rien d’anormal à ce que croisse, de toute façon, cet écart car c’est là une conséquence du mouvement « naturel », « normal », inéluctable de l’accumulation capitaliste.
En effet, plus l’accumulation croît, plus croît aussi l’importance des moyens de production utilisés, donc la masse d’argent (le capital constant, Cc) qui doit être avancée par les actionnaires et autres créanciers pour leurs achat, entretien et fonctionnement. En même temps, décroît, relativement à cette masse de capital constant, la masse d’argent (Cv) qui achète la force de travail en étant convertie en salaires. Cela ne veut pas dire que la masse salariale décroît nécessairement, bien que, lorsque la crise prend de l’ampleur, cela finisse par arriver sous le double effet de la baisse des salaires réels et de la quantité de travail employé. Au contraire, elle a pu augmenter mondialement avec le développement capitaliste des pays « émergents » (Chine, Inde, Brésil, etc.) qui a transformé des dizaines de millions de paysans en prolétaires urbains. Mais cela veut dire qu’au « mieux », elle tend nécessairement à croître en valeur (Cv) moins que n’augmente celle de la masse de capital constant (Cc)67. Et cette loi du capital se manifeste y compris dans les pays développés, où les salaires ont même baissé. Cette baisse des salaires y est d’ailleurs relativement ancienne. En glissement annuel, les salaires réels (c’est-à-dire compte tenu de l’inflation) ont baissé en moyenne de 0,8 % en Grande Bretagne ainsi qu’en zone euro de 1996 à 2009, de 3 % aux USA68. Mais qui plus est, cette évolution de la moyenne des salaires réels ne rend pas compte de la réalité69 puisque: 1°) elle inclut une hausse très importante des salaires les plus élevés qui masque la baisse de ceux de la grande majorité; 2°) elle ne prend pas en compte la baisse du salaire indirect, c’est-à-dire des prestations sociales qui représentent souvent une part importante du revenu prolétaire (42 % en France par exemple); 3°) elle omet aussi l’augmentation du nombre de non salariés pour cause de chômage. Enfin, il faut ajouter que, dans le même temps, les dépenses quasi obligatoires augmentaient. Ainsi en est-il, par exemple, des transports, conséquence de l’urbanisation capitaliste imposant l’éloignement des lieux de travail, ou aussi du développement d’Internet puisque de plus en plus d’actes de la vie courante exigent de l’utiliser, transférant ainsi des coûts des entreprises aux particuliers.
Comme nous l’avons rappelé au chapitre 1, les revenus allant aux capitalistes (à tous, passifs et actifs)70 croissent toujours plus que ceux allant aux prolétaires. Ces derniers finissent même par décroître absolument. C’est là une loi découlant des augmentations de productivité, lesquelles sont la dynamique propre du mode de production capitaliste. Il en résulte qu’une part plus importante de la richesse produite doit revenir aux propriétaires du capital constant puisque ce dernier représente une part plus importante de sa valeur. Tandis que la part de cette valeur imputable au travail vivant diminuera, sinon de manière absolue, du moins relativement. En effet, la part revenant au capital constant doit pouvoir, premièrement, assurer son renouvellement (amortissement) et son accroissement, ainsi qu’un profit aux créanciers, propriétaires de l’argent avancé pour constituer ce capital constant. Ce profit, part de plus-value qui leur revient sous forme de dividendes, d’intérêts ou de rentes, doit d’ailleurs croître en proportion de ces avances afin que son taux reste stable. Cela, Marx l’avait parfaitement analysé. Il écrivait: « Avec le progrès de la productivité du travail social, accompagné qu’il est d’un accroissement du capital constant, une partie relativement toujours plus grande du produit annuel du travail échoira aussi au capital en tant que tel, et par là même la propriété du capital (indépendamment du revenu) augmentera constamment et la proportion de la valeur créée par l’ouvrier individuel, et même la classe ouvrière, diminuera de plus en plus par rapport au produit de leur travail passé qui leur fait face en tant que capital »71. De plus, la part du produit du travail revenant au capital doit aussi pouvoir assurer la rémunération des capitalistes actifs, maîtres et possesseurs du procès de production concret. Ainsi, les hauts dirigeants et les équipes qui les entourent ont vu leurs revenus (salaires, stock options, bonus, retraites, etc.) incroyablement exploser ces 20 dernières années. On observe donc aujourd’hui les effets de cette loi de l’écart croissant entre, d’un côté les revenus du patrimoine et d’activité des capitalistes, et de l’autre la précarité grandissante du travail prolétaire faisant des ravages sur leurs revenus, même si le salaire horaire nominal augmente encore un peu, dans certaines périodes.
C’est là un mouvement historique qui s’est développé du 19ème siècle à nos jours. Il n’y a donc rien d’anormal à constater qu’au fur et à mesure que le capital s’accumule sous ses formes matérielles et financières, la part revenant aux salaires dans la répartition de la richesse nationale tende à diminuer relativement par rapport à celle revenant aux divers propriétaires du capital. La part des revenus tirés des patrimoines, notamment, s’accroît sans cesse par effet cumulatif. Il est évident qu’un même gain de 3 % augmente de 30 un patrimoine de 1000, contre 3 seulement pour un patrimoine de 100. Le fait que cet écart se soit accru de façon inouïe ces dernières années n’est pas le plus significatif même si cela est spectaculairement scandaleux et propre à déchaîner de justes colères. Ce n’est pas tant « l’exagération » du phénomène qu’il faut comprendre que le phénomène lui-même, caché derrière son exagération. Cela permet de passer sous silence cette loi de l’accumulation capitaliste. D’ailleurs, les « régulateurs » l’ignorent. Ils imaginent même que le scénario inverse soit possible puisqu’ils proposent de relancer la croissance du capitalisme au moyen d’une réduction drastique de la masse des profits afin d’augmenter celle des salaires. Et qui plus est, au moment même où ces profits s’effondrent avec la crise.
En fait les « régulateurs » sont soumis à ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise. Ils ne comprennent pas le capitalisme comme un rapport social d’appropriation et de production entre des hommes, mais comme un rapport entre des choses telles les profits, les salaires, les prix, la monnaie, etc. Tous les problèmes viendraient, selon eux, d’un mauvais dosage entre les quantités de ces choses:
– trop de crédits, de titres financiers et pas assez de capital matérialisé, « réel »,
– trop de profits et pas assez de salaires,
– trop de production et pas assez de consommation, etc.
Ils se voient en experts capables d’établir correctement ces proportions, ce qui, selon eux, permettrait de réguler à peu près harmonieusement la croissance capitaliste. Prétendre relancer la production en prenant sur les profits pour augmenter les salaires et, de là, la consommation, puis la production et créer ainsi ce que certains appellent une spirale vertueuse, est un raisonnement simpliste basé sur une série d’erreurs. La plus évidente consiste à considérer « la » production comme une abstraction alors qu’elle a une détermination concrète, précise dans le système capitalisme: elle est production de profit. Pas de production sans plus-value et taux de profit suffisants. Il ne peut y être question d’un angélique « partage de la valeur ajoutée » dont déciderait une quelconque instance arbitrale neutre, au dessus des classes sociales. Celle que formeraient, par exemple, de soi-disant scientifiques économistes indépendants. Croire cela revient à faire du boniment comme sait si bien le faire Sarkozy lorsqu’il évoque la possibilité d’un partage en trois tiers, sortis d’on ne sait quel chapeau: un tiers pour l’investissement, un tiers pour les profits et un tiers pour les salaires. Le mouvement historique de l’accumulation du capital est inévitablement celui d’un écart – et d’un antagonisme – croissant entre le pôle du capital qui accumule et celui du travail qui est dépouillé.
En même temps, les « régulateurs » séparent arbitrairement production et réalisation de la plus-value, production et consommation des marchandises alors que le cycle de reproduction du capital englobe tous ces moments dans un seul et même procès. Selon eux, en augmentant exagérément leurs profits par « trop » d’avidité, les capitalistes compriment « trop » les salaires au point de produire un « excès » de plus-value tel que celle-ci ne peut plus se réaliser, la consommation demeurant trop faible. La crise serait donc un problème de réalisation de la pl. Augmenter les salaires en diminuant la pl résoudrait le problème. Dans la même veine, mais vu sous l’angle non plus de l’argent mais des marchandises, ils voient, d’une part, des surcapacités de production, et d’autre part, une sous-consommation. La crise serait alors une crise des débouchés. Même analyse et même solution: augmenter les salaires. Ce qui permettrait une consommation plus élevée sans crédits excessifs! Salaires plus élevés, profits rognés, crédits réglementés et limités, voilà une potion magique propre à envoyer le capitalisme au tapis plutôt qu’à le réguler comme elle le prétend!
En fait, les régulateurs ne comprennent pas que le problème n’est pas seulement la réalisation de la pl, mais d’abord sa production: comme nous l’avons montré précédemment, quand la rentabilité des investissements décroît, il y a blocage de l’accumulation (cf. Chapitre 1). Le problème n’est pas surcapacité des moyens de production d’un côté et sous-consommation de l’autre puisqu’il s’agit du même phénomène de suraccumulation/sous-consommation simultanées ayant la même cause immédiate (les gains de productivité). Il s’agit là du mouvement même du capital existant comme procès de valorisation-reproduction-accumulation. Mouvement qui implique cet apparent paradoxe et véritable contradiction du capitalisme: que l’extorsion accrue de pl qui est le but de chaque capitaliste s’accompagne de la diminution, relative puis absolue, du travail vivant employé, celui-là même qui produit la pl. C’est cette diminution qui agit dans tous les moments du cycle de la production de pl; dans sa production stricto-sensu comme augmentation de la composition organique Cc/Cv, et dans sa réalisation comme sous-consommation.
Les « régulateurs » et autres réformistes affirment qu’une mauvaise politique est cause de la crise. Mais, au bout du compte, nous voyons qu’ils ne voient pas que l’économie est politique. Ils ne comprennent pas que le politique est ce qui organise l’ensemble de la société, l’ensemble des rapports sociaux entre les hommes à partir de ce qu’ils sont dans la production des moyens et des conditions de leur existence. Soumis au fétichisme de la marchandise, ne voyant que les rapports entre les choses, ne prenant en considération que les aspects purement quantitatifs qui sont les apparences du rapport social d’appropriation capitaliste, ils ne voient rien de ce qui fait l’essentiel des rapports entre les hommes c’est-à-dire leurs aspects qualitatifs. La politique économique qui ne touche pas à ces rapports d’appropriation, de division du travail et des connaissances, ne peut qu’accompagner et organiser l’accumulation capitaliste selon ses lois et ses contradictions, ou si elle prétend faire autre chose, n’être qu’utopique, inapplicable sauf à engendrer des catastrophes.
4.3 Une sortie de crise par les grands travaux ou grâce à « l’industrie verte »?
Pour en terminer avec l’examen des propositions de sortie de crise qui font l’objet d’un affichage médiatique et qui vont au-delà du sauvetage du seul secteur financier, disons un mot de celles qui préconisent une relance de la production par de « grands travaux » financés par l’Etat ou encore par le financement étatique de nouvelles productions, une « industrie verte » par exemple.
Des grands travaux (autoroutes, TGV, stades ou autres), ça fait survivre les entreprises du BTP un temps supplémentaire mais artificiellement car, ce faisant, la dette publique s’accumule et accroît le capital fictif qui exige sa part de profits. Cela ne résout donc rien au problème de la suraccumulation de capital, au contraire, puisque cela retarde les nécessaires destructions de capitaux excédentaires. Une industrie verte ne résoudrait rien non plus de ce problème puisqu’elle ferait monter les coûts de production, serait soutenue par l’Etat à l’aide de nouveaux impôts pesant sur les ménages, et ferait donc baisser la consommation.
Cette « relance par l’offre » qui se distinguerait de la « relance par la demande » des « régulateurs » que nous venons d’examiner relève du même bricolage superficiel qui ignore les vraies causes de la crise. L’échec flagrant d’une relance de ce type dans les années 30 du New Deal de Roosevelt, avec cependant des moyens considérables, suffit à établir l’incapacité de telles mesures à résoudre la crise. D’une façon plus générale, ces dépenses étatiques qui augmentent la dette publique, augmentent aussi la probabilité d’une faillite financière des Etats eux-mêmes. Elles sont une forme de protectionnisme, chaque pays cherchant, par ces moyens, à éviter que ce soit ses propres entreprises qui disparaissent dans la crise. Si elles ne résolvent rien des problèmes posés par la crise, elles contribuent par contre à aviver les rivalités et à élever le niveau des conflits entre les nations.
Nous avons fait un rapide tour d’horizon des faux diagnostics concernant les causes de la crise et des fausses solutions pour la surmonter qui en découlent. Nous avons posé le vrai diagnostic de la crise dans le phénomène de suraccumulation/sous-consommation qui se traduit par une chute du taux de profit. Il nous reste maintenant à examiner les moyens de résoudre ce problème là.
Ils sont de deux types. Soit on vise à rétablir le taux de profit qui permettrait de démarrer un nouveau cycle de valorisation et d’accumulation du capital et on se situe dans une perspective de perpétuation du système capitaliste et d’aggravation considérable de la situation des masses prolétaires du monde entier, comme nous allons maintenant le démontrer (chapitre 5). Soit on envisage de supprimer carrément les causes qui sont à la racine du problème et on se situe alors nécessairement dans une perspective révolutionnaire visant à renverser le système et à lui en substituer un autre plus humain.
La bourgeoisie, sans l’afficher médiatiquement, prend toutes les mesures qu’elle peut pour imposer la première solution. Les prolétaires sont amenés à lutter contre ces mesures, mais ils doivent comprendre qu’ils ne peuvent réellement s’en sortir que par la seconde solution. Toutes deux ont un point commun essentiel qui se situe dans les rapports sociaux de production. Ce sont ceux-ci que la bourgeoisie doit transformer pour accroître l’exploitation des prolétaires et restaurer ainsi le taux de profit. Ce sont ceux-ci que le prolétariat doit abolir s’il veut sortir de la situation catastrophique qu’il devra sinon subir.

