LA POLITIQUE DU CAPITAL DANS LA CRISE
Publié par admin on Mai 13, 2013 | 0 commentaire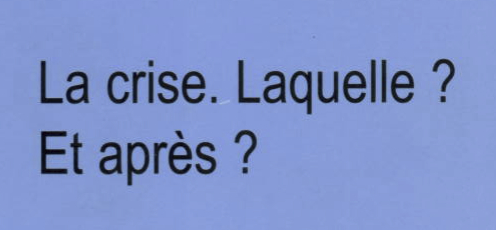
CHAPITRE 5 du livre de Tom Thomas « La crise. Laquelle? Et après? »
Nous savons qu’il ne s’agit pas d’une crise due aux « excès » financiers d’une politique libérale, mais bien à une baisse du taux de profit engendrée par un phénomène de suraccumulation/sous-consommation et aggravée par une hyperinflation de capital financier fictif. Au-delà du sauvetage du système financier que les Etats étaient dans l’obligation d’entreprendre de toute urgence, mais dont nous avons montré qu’il ne constituait nullement une solution à la crise, il nous faut donc examiner comment le capital et ses fonctionnaires œuvrent à redresser le taux de profit dans la situation concrète du capitalisme, spécifique à ce stade de son développement historique.
Evidemment, il leur faut agir sur les facteurs qui constituent ce taux, pl et Cc + Cv, soit aussi la composition organique Cc/Cv et le taux d’exploitation pl/Cv. Rappelons en effet que le taux de profit est pl/Cc + Cv, qui peut s’écrire pl/Cv/Cc/Cv + 1. Il s’agit donc d’essayer d’augmenter pl/Cv tout en augmentant moins vite, voire en diminuant Cc/Cv. Ceci devient objectivement de plus en plus difficile compte tenu du haut niveau de productivité déjà atteint. C’est pourquoi la solution principale consiste à augmenter pl/Cv, qui est le taux de plus-value et aussi le taux d’exploitation.
Avec la crise, les lois du marché agissent aveuglément dans ce sens. Le capital constant est dévalorisé. Des entreprises en difficulté peuvent être rachetées à bas prix. Les prix des matières premières s’écroulent. Les salaires sont laminés sous la pression d’un chômage massif. Il y a là des facteurs favorables à un redressement du taux de profit. Néanmoins, ils sont limités car, en même temps que ces phénomènes se produisent, la composition organique reste élevée puisque l’importance du capital fixe reste prépondérante, que la consommation diminue en même temps que la quantité de travail vivant utilisée. Une forte destruction de capitaux, marquée par des dettes non remboursées, des faillites, des fermetures d’usines, est évidemment beaucoup plus efficace pour relever le taux de profit. Du côté financier d’abord, où les centaines de milliards de dollars de capitaux fictifs qui s’évaporent favorisent un redressement du taux de profit moyen. L’effondrement des cours boursiers induit d’ailleurs une amélioration des rendements financiers car les ratios bénéfices/prix des actions montent malgré la baisse des bénéfices. Il constitue ainsi en lui-même une contre-tendance. Du côté du capital matérialisé ensuite, la destruction d’une masse importante d’entreprises élimine les moins performantes, ce qui tend aussi à élever le taux de profit moyen et à diminuer la suraccumulation relative à ce taux de profit.
Cependant, toutes ces évolutions ne changent rien à la structure même des rapports de production dont la crise a montré qu’ils ne permettaient plus la poursuite du procès de valorisation et de reproduction du capital, notamment la poursuite de gains de productivité suffisamment générateurs de plus-value supplémentaire. A supposer même – supposition toute théorique – que ces évolutions permettent une reprise de ce procès, ce serait tout à fait éphémère puisque les mêmes causes produiraient immédiatement les mêmes effets. Le carburant nécessaire et essentiel de la reproduction du capital est toujours la croissance de la production de pl. Or ceci passe, pas uniquement mais fondamentalement, par l’accroissement du taux de pl, ou taux d’exploitation, pl/Cv. Et cela implique directement les rapports sociaux de production, comme nous allons le voir. Accroître ce taux est un problème qui, avec la crise, concerne d’autant plus chaque capital qu’il s’agit de ne pas être celui qui sera éliminé mais, au contraire, d’être celui qui sera le moins dévalorisé, celui qui conservera la meilleure capacité à se reproduire. Ce problème concerne aussi les Etats. Ceux-ci doivent en effet reproduire les sociétés qu’ils organisent et donc chercher à y maintenir les capitaux, les emplois, les centres financiers où refluent les profits des multinationales. La crise aiguise ainsi les rivalités en même temps qu’elle favorise une concentration accrue de capitaux.
Et pour gagner cette bataille – du moins tant qu’elle ne tourne pas au seul affrontement militaire – la priorité est d’augmenter le taux d’exploitation, de modifier les rapports de production précédents devenus obsolètes. Le rôle de l’Etat est alors essentiel car il n’y a que lui qui peut avoir la force de peut-être réussir à imposer aux prolétaires les changements qui aggraveront considérablement leur situation puisqu’il s’agit d’obtenir une forte extorsion de plus-value supplémentaire.
Pour y parvenir, l’Etat devra abandonner ses derniers oripeaux démocratiques, se faire ouvertement policier et totalitaire. Ce processus est déjà partout en cours. L’Etat devra aussi jouer de son hégémonie pour essayer de souder le peuple derrière lui dans les batailles et guerres qui se multiplieront entre blocs rivaux pour la domination et l’accaparement des richesses mondiales. Pour ce faire, il s’emploiera à faire apparaître la concurrence entre capitaux comme une concurrence entre peuples, ce que la bourgeoisie a déjà réussi à faire mainte fois dans l’histoire. Ces guerres impérialistes seront et sont déjà présentées comme une mission civilisatrice imposant « les droits de l’homme » et la démocratie et extirpant le terrorisme.
L’étatisme est le plus grand danger qui risque d’obscurcir la conscience ouvrière dans les luttes décisives qu’elle aura à mener au cours des prochaines années. C’est pourquoi, il convient de s’y attaquer en priorité en montrant où mènent toutes les positions qui préconisent de renforcer le rôle de l’Etat, inclusion faite des positions dites de gauche qui ne se distinguent en cela de la droite qu’en lui reprochant de ne pas le faire assez.
5.1 Les effets des interventions de l’Etat pour sauver le système financier
Nous avons déjà constaté un premier résultat des interventions de l’Etat pour sauver le système financier: une énorme création monétaire pour subventionner ou nationaliser les banques et autres entreprises en déroute, au moyen d’un gonflement tout aussi énorme des dettes publiques et de l’absorption par les banques centrales d’un monceau de créances « toxiques » et de titres de la dette de l’Etat. Dans le plus grand centre financier du monde, « la base monétaire des Etats-Unis, c’est-à-dire la liquidité créée par la Réserve fédérale, a augmenté de 140 % en un an »72, alors même que la production et les échanges stagnaient. Cela entraînera « une hausse qui devra être forte de la pression fiscale », donc une baisse de la consommation et de l’activité, et une hausse du chômage. Mais cela ne suffira pas vu l’ampleur pharaonique des dettes publiques73 et le ralentissement de l’activité qui ne sera pas résorbé pour autant. L’Etat devra recourir à de nouvelles émissions monétaires; le remboursement de ses dettes se fera donc en monnaie dévalorisée74, ce qui s’apparente à un moratoire. D’ailleurs, rien ne dit qu’il ne décrétera pas ouvertement un tel moratoire. Il y rajoutera aussi évidemment, comme il a déjà commencé à le faire à grande échelle, une réduction drastique des dépenses publiques dans les domaines de la santé, de l’éducation, des aides sociales, etc. Il continuera à augmenter les dépenses policières et les aides à la valorisation des capitaux. Il le fera notamment en accentuant la diminution des charges sociales payées par les entreprises. Cette méthode d’abaissement des coûts salariaux systématiquement utilisée depuis les gouvernements de gauche des années 80 semble inéluctable, quels que soient les gouvernements.
Pour le moment, cette inflation monétaire ne se traduit pas en hausse importante des prix des biens de consommation. Les liquidités fournies:
– servent à effacer les dettes privées, ce qui réduit d’autant la masse monétaire, ou
– sont thésaurisées en attente de la fin de la crise, ou encore
– se placent en titres des dettes des Etats considérés comme les plus sûrs, les USA au premier chef, mais aussi l’Europe et le Japon.
Tout cela a pour effet de gonfler une nouvelle bulle financière. Celle-ci éclatera immanquablement, ne serait-ce que parce que les prix de ces titres s’effondreront avec la hausse des taux d’intérêts des nouvelles émissions75. Cette hausse adviendra quand les prêteurs rechigneront à continuer à les acheter, lorsqu’ils réaliseront qu’ils seront remboursés en monnaie de singe du fait de la masse qui en a été émise. Déjà, en ce début 2009, on a vu la Chine, principal acheteur de titres US, et d’autres pays marquer leur défiance à l’égard de la valeur future du dollar.
La mondialisation a d’ailleurs permis jusqu’ici de contenir la hausse des prix nominaux des biens de consommation dans des limites basses en renforçant la pression à la baisse des coûts salariaux. La crise, avec le bradage des marchandises dans le climat de concurrence exacerbée qu’elle induit dans un premier temps, renforce cette tendance immédiate au ralentissement de la hausse des prix jusqu’à même produire une baisse (déflation).
Mais cette situation pourrait évoluer au cours de la crise sous l’influence de divers facteurs tels que, par exemple:
– l’affaiblissement de la concurrence due à la diminution de la production du fait de la faillite de nombreuses entreprises et à l’accentuation de la concentration oligopolistique;
– la résistance ouvrière à de plus fortes baisses de salaires, y compris dans les pays émergents;
– l’élévation des barrières protectionnistes;
– l’augmentation des dépenses militaires;
– les dévalorisations monétaires massives et généralisées que nous avons évoquées ci-dessus.
Alors, l’inflation dans la sphère financière se doublerait de la hausse des prix des marchandises qui prendrait son essor et aggraverait la situation de toutes les couches populaires, jusqu’aux classes « moyennes ». Du point de vue de la reprise de l’accumulation du capital, surgirait alors une double difficulté: on assisterait à une nouvelle baisse de la consommation et à un affaiblissement du système de crédit dont un fondement réside dans la stabilité du pouvoir d’achat de la monnaie, dans sa capacité à conserver la valeur. A cela viendrait s’ajouter l’obstacle de la décomposition sociale et de la lutte de classe que cette situation engendrerait. On verrait ainsi se développer une situation de « stagflation » c’est-à-dire une inflation des prix associée à une stagnation voire à un recul de la production et de l’accumulation.
Inflation, déflation, stagflation des prix nominaux? La question n’est pas de faire des prophéties sur l’évolution des prix nominaux. Divers scenarii sont en effet possibles. La dévalorisation monétaire que génère l’émission massive de liquidités n’implique pas automatiquement une hausse proportionnelle des prix des marchandises (d’autres facteurs entrent dans la détermination de ces prix)76. Elle peut n’affecter que le système du crédit qui exige la conservation de la valeur de la monnaie. Mais surtout, faire de telles prophéties n’a guère d’intérêt puisque la sortie de crise ne relève pas essentiellement de la question monétaire et des prix nominaux. Elle relève, répétons-le, de la quantité de plus-value contenue dans la valeur produite.
Observons, pour en revenir sur ce terrain, qu’au-delà du facteur conjoncturel de la mondialisation quant à la baisse des prix, il y a une tendance structurelle, permanente, de fond à cette baisse du fait des hausses constantes de productivité qui caractérisent l’accumulation du capital et qui abaissent les valeurs des marchandises, lesquelles sont au fondement des prix réels.
Cette tendance déflationniste des valeurs est un problème à résoudre par le capital. Il s’agit toujours de la baisse du taux de profit, à savoir qu’à force de diminuer la valeur des marchandises par les gains de productivité, le capital finit par diminuer aussi la plus-value qui n’en est qu’une partie (ceci même s’il parvient pendant un certain temps à contrer cette tendance en diminuant la part salariale au profit de la pl). Nous reviendrons plus loin sur cette question.
Et si l’émission monétaire à laquelle les Etats procèdent pour sauver le système financier parvient, tellement elle est massive, à ce que cette tendance déflationniste de fond soit contrecarrée et dépassée par une inflation, alors le capital en tirerait sans doute un avantage immédiat puisque la hausse des salaires ne suivrait pas celle des prix. Mais toutes les conséquences négatives de la dévalorisation monétaire n’en seraient qu’accentuées en ce qui concerne le système de crédit. D’abord, les taux d’intérêts y seraient bas parce que les liquidités fournies par les Etats seraient abondantes, et qu’elles seraient dirigées vers la sphère financière, notamment vers les titres d’Etat. Mais avec la prise de conscience de la dévalorisation monétaire et de la baisse du pouvoir d’achat de la monnaie, la crainte des créanciers d’être remboursés en monnaie de singe serait décuplée. Alors ils seraient rétifs à prêter, et les taux d’intérêts remonteraient. Les investissements deviendraient de plus en plus coûteux, la consommation ralentirait et l’accumulation se bloquerait à nouveau.
C’est bien parce que le capitalisme moderne nécessite un système de crédit ultradéveloppé, donc une monnaie stable, conservant la valeur, que le « monétarisme » et la soi-disant indépendance des banques centrales77 se sont imposés comme une nécessité après les années 70 de forte inflation.
En réalité, le procès de valorisation du capital n’est pas fondé sur la monnaie, bien qu’elle lui soit évidemment nécessaire et que son rôle s’accroît avec l’importance qu’y prend le crédit pour qui la stabilité monétaire est une exigence. Il est fondé sur l’augmentation de la masse de valeur produite générant toujours plus de plus-value. On en revient à ce constat que la crise n’est pas financière, que le sauvetage du système financier, pour nécessaire et urgent qu’il soit pour le capital, ne résout pas pour autant le problème de fond que la crise révèle. Non seulement le système financier ne fait que fournir par le crédit une dose de dopant supplémentaire au capital, mais en augmentant la dette publique, il en fait payer l’énorme prix aux couches populaires.
Pour que le capital puisse relever son taux de profit moyen et reprendre son procès de valorisation et d’accumulation, deux conditions complémentaires doivent essentiellement être réunies au-delà du maintien à flot du système financier: première condition, détruire une grande masse de capitaux, non seulement sous leurs formes financières mais aussi sous leurs formes matérialisées, pour en réduire « l’excédent » et aussi pour pouvoir reconstruire un système de production qui permette, deuxième condition, d’augmenter le taux d’exploitation pl/Cv (réduire la composition organique du capital n’est, aujourd’hui, qu’une possibilité au mieux mineure). C’est ce dernier point que nous allons examiner puisqu’il concerne la transformation des rapports de production, le cœur de la lutte des classes.
5.2 Les effets des interventions de l’Etat dans les rapports de production
Pour augmenter le taux de profit, le principe est simple à définir. Il s’agit d’augmenter la pl ou/et de diminuer le capital engagé Cc + Cv. Mais il est plus difficile à appliquer, et c’est là tout ce qui distingue l’habile capitaliste du moins bon. Pour y parvenir, il dispose de deux moyens essentiels en dehors d’autres contre-tendances dont nous reparlerons plus loin: augmenter l’extraction de la pl sous sa forme absolue, ou l’augmenter sous sa forme relative. Ces deux moyens sont presque toujours employés simultanément bien que le second ait été, et de loin, le plus employé et le plus efficace. On les confond souvent. D’une part, parce que le résultat recherché est évidemment le même: il s’agit toujours d’augmenter la part de travail non payé (le surtravail qui est la plus-value potentielle) dans la valeur produite. D’autre part, parce qu’un des moyens d’augmenter la pl absolue, celui qui consiste à augmenter l’intensité du travail, c’est-à-dire la quantité de travail fournie dans un même temps, exige toujours ou presque une amélioration du système des machines, laquelle s’accompagne alors aussi d’une augmentation de la pl relative, c’est-à-dire d’une amélioration de la productivité. Mais il convient cependant de bien comprendre ce qui les distingue, car nous verrons que le fort ralentissement de l’extraction de la pl sous sa forme relative, à partir des années 70, explique le recours acharné de son extraction sous sa forme absolue qu’à, depuis ces années, entrepris le capital. Recours qu’il accentue et va encore accentuer pour tenter de surmonter sa crise. Ce qui a des conséquences importantes sur la lutte des classes.
Examinons donc cette distinction.
L’augmentation de la pl relative est obtenue par une diminution du capital à engager (Cc + Cv) pour une production de valeur donnée. Cela implique d’utiliser des machines plus perfectionnées. Cc, l’intensité capitalistique, augmente mais Cv, la quantité de travail vivant employée, diminue davantage. Le solde marque donc une diminution, de sorte que la part de la pl dans la valeur du produit (Cc + Cv + pl) augmente. On connait l’extraordinaire développement de la science et de ses applications aux machines, de la productivité horaire du travail et de la production que la recherche constante de l’augmentation de la pl relative a engendré. Mais on connaît aussi ses limites: l’augmentation de la composition organique du capital et la baisse relative concomitante de la masse salariale, donc de la consommation. Ce sont ces limites qui ont affecté les pays industrialisés78 dans les années 1960-70 ouvrant la période de crise généralisée qui culmine aujourd’hui.
Ces limites ont plusieurs causes, dont les deux principales sont les suivantes:
1°) Les investissements nécessaires pour obtenir des gains de productivité additionnels étaient devenus très lourds du fait de la puissante sophistication des technologies déjà mises en œuvre. Les économies sur la quantité de travail vivant et donc sur la masse salariale restaient nécessaires mais devenaient de plus en plus difficiles à obtenir du fait qu’elle était déjà fort réduite par rapport à l’énorme quantité de marchandises produites. Autrement dit, le gain de productivité exigeait une augmentation considérable de Cc difficile à compenser par une diminution qui devait être encore plus grande de Cv (phénomène dit des rendements décroissants).
2°) La résistance ouvrière au travail ultra-parcellisé s’accroissait. Le travail abrutissant et exténuant de la chaîne fordiste était contesté. Les cadences infernales, sans cesse relevées, généraient des actes de sabotage. Cette résistance accrue était facilitée par une situation de relatif plein emploi et par la grande concentration prolétaire au sein de l’usine fordiste. Les manifestations de mécontentement trouvaient mille prétextes pour ralentir la production. La qualité des produits était notoirement affectée à cause de la fatigue mais aussi à cause des multiples actes de petits sabotages. De sorte que le nombre croissant de rebuts devenait de plus en plus coûteux pour le capital. Des pièces à retoucher ou à refaire, c’est autant de temps de travail machine et humain, de capital engagé jeté à la poubelle. Et sur des centaines de postes de travail, un petit pourcentage de rebuts sur chacun fait une très grosse perte au total, sans compter les pertes de clients mécontents. La résistance ouvrière s’est aussi manifestée dans les grandes grèves qui ont culminé en France et en Italie, notamment à la fin des années 60. Débordant les syndicats cogestionnaires, ces mouvements sociaux ont fini par imposer une limite à l’accentuation du taux d’exploitation obtenu par ce type d’organisation et de division sociale du travail. Briser cette résistance en allant chercher ailleurs une masse de main d’œuvre disponible pour faire pression sur les salaires et modifier les rapports de production pour transformer l’usine « fordiste » devenait une nécessité pour le capital.
Venons-en maintenant à l’extraction de la plus-value sous sa forme absolue.
Comme il était devenu difficile d’augmenter substantiellement l’extraction de la plus-value sous sa forme relative, il fallait à la bourgeoisie mettre l’accent sur une relance de cette extraction sous la forme absolue. Rappelons qu’il s’agit là, non pas de la diminution de la part du travail nécessaire (celle qui s’échange contre le salaire, Cv) relativement à celle de la pl par le moyen de l’usage de machines plus performantes, mais de l’augmentation de la quantité de travail vivant obtenue par le moyen d’un allongement de la journée de travail ou/et par l’intensité du travail fourni en un temps donné: accélération des cadences, simplification, densification et accélération des gestes pour éliminer tous les « pores » d’inactivité, « chasse aux temps morts », et autres moyens que nous détaillerons plus loin. Il s’agit là de la classique méthode tayloriste, mais qui va aussi être modifiée de telle sorte qu’il n’y ait pas, ou le moins possible, d’accroissement simultané important de capital fixe (machinerie) dont on a rappelé combien il était aujourd’hui difficilement rentable.
La méthode tayloriste, dont les astuces sont bien connues, impliquait une hausse de l’utilisation des machines, ce que Ford perfectionna avec la chaîne. Cette méthode était déjà entièrement liée, et même soumise à l’objectif d’augmenter l’intensité du travail et de chasser la « paresse ouvrière », véritable obsession de Taylor. Modernisée, elle consiste à augmenter la quantité de travail non payé de l’ouvrier (surtravail) sans augmenter, ou le moins possible, le capital fixe. Il ne s’agit pas d’allonger le temps de travail en même temps que l’intensité car les deux sont rapidement incompatibles, l’intensification exigeant un ouvrier autant que possible « frais et dispos ». Certes, cette augmentation zéro du capital fixe est un idéal tout théorique, mais c’est celui que cherchent à approcher au plus près les mesures prises depuis quelques années et accentuées tous les jours. Mesures auxquelles s’ajoutent celles visant une diminution absolue des revenus ouvriers, salaires directs et indirects et sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Or cela a de multiples conséquences concernant la lutte des classes. Dès maintenant, notons celle-ci: le renforcement du totalitarisme étatique du fait que ces mesures impliquent une lutte ouverte et brutale contre les prolétaires (et ici la difficulté pour beaucoup de travailleurs est de comprendre qu’il s’agit de l’Etat quel que soit son gouvernement). En effet, l’extraction de la plus-value relative constitue un mode d’exploitation relativement pacifique, relativement indolore, car l’augmentation de la plus-value y apparaît comme due au perfectionnement des machines, donc à ce qui vient du côté du capital et des scientifiques que celui-ci s’est attaché et non du côté des prolétaires. De plus, comme ces gains induisent une production plus massive et abaissent les prix des marchandises, ils peuvent même permettre, dans une phase de croissance forte telle que celle dite des « Trente Glorieuses »79 d’après guerre d’en laisser quelques miettes aux ouvriers et d’augmenter quelque peu leur pouvoir d’achat, tout en réduisant aussi leur temps de travail hebdomadaire et annuel (congés payés). C’était l’époque des « acquis sociaux » du soi-disant Etat Providence. Tandis que l’extraction de la plus-value absolue est une forme beaucoup plus ouverte, visible, évidente de l’exploitation, car l’augmentation de la plus-value y apparaît nettement comme due entièrement à ce qui vient du côté du travail ouvrier. Celui-ci est allongé, intensifié, flexibilisé, et qui plus est, avec la crise, de moins en moins payé. Il faut donc une violence et une dictature accrue de l’Etat pour imposer la destruction des acquis sociaux de l’Etat Providence ainsi que ces mesures d’exploitation ouvertement accrues80. Ces transformations des rapports sociaux sont et seront encore accentuées dans le cadre de la crise actuelle.
On sait que ce tournant fut amorcé dans les pays industrialisés par les Reagan, Thatcher, Mitterrand. La victoire de la bourgeoisie fut alors écrasante, illustrée notamment par l’échec total de quelques grandes grèves emblématiques, telles celles des contrôleurs aériens US, des mineurs anglais, des sidérurgistes français. A partir de ces échecs, apparurent les premières modifications des rapports sociaux. Depuis, elles ont été patiemment et systématiquement développées et aggravées. Elles devront l’être encore bien davantage car la crise ouverte en a révélé toute l’insuffisance pour relancer le procès d’accumulation capitaliste. L’exemple français est une bonne illustration de la mise en place de cette politique dite libérale par un gouvernement de gauche. Politique qui continue aujourd’hui, menée par un gouvernement de droite, au moyen d’un étatisme qui a dû être renforcé. Ce qui démontre bien que le capital en crise exige les mêmes remèdes quels que soient les gouvernements et les moyens mis en œuvre pour les faire ingurgiter au peuple, et que libéralisme et étatisme ne sont que deux formes de la politique bourgeoise.
Résumons brièvement ces débuts dans lesquels toute la suite s’annonce.
a) Echec total en 1981-83 de la tentative d’exhumer le vieux programme réformiste de la gauche qui prouve, une fois de plus, son incapacité à modifier le cours du capitalisme. Elle en tire la leçon en se lançant à corps perdu dans le « libéralisme ».
b) Première mesure pour pouvoir abaisser les salaires afin d’augmenter la pl: la désindexation de l’évolution des prix. Leur indexation, bien que tronquée, avait néanmoins une certaine réalité pendant la phase fordiste.
c) Deuxième mesure pour passer à l’acte, mais « par la bande »: décharger le capital du paiement des charges sociales (le salaire indirect), sous prétexte de favoriser l’emploi. Initiée par le gouvernement Fabius, cette politique sera sans cesse poursuivie et accentuée ensuite par tous les gouvernements de droite ou de gauche puisqu’elle présente l’avantage de ne pas toucher au salaire direct et de faire payer ce salaire indirect par les salariés eux-mêmes en le fiscalisant!
d) Troisième série de mesures pour augmenter le taux de plus-value, et tout particulièrement par le moyen de la pl absolue: les lois Aubry de 1998 et 2000 sur les 35 heures hebdomadaires de travail. Mesures qu’il est intéressant de rappeler dans leurs grandes lignes parce qu’elles ont été présentées comme une grande réforme favorable aux travailleurs alors qu’elles jettent les bases de la modification des rapports de production qui seront ensuite sans cesse amplifiées dans un sens toujours néfaste pour eux. Quelles sont donc ces grandes lignes?
– Les modalités d’application des 35 heures devaient faire l’objet d’accords, entreprise par entreprise. Ceci a ouvert la voie à la division des prolétaires en autant de petits sous-groupes impuissants, et au-delà, a renforcé l’individualisation du rapport salarial. Les patrons sont évidemment très favorables à cette individualisation car elle met le prolétaire totalement à leur merci.
– En légalisant l’annualisation du temps de travail en lieu et place de la limite hebdomadaire, le gouvernement ouvrait la porte au développement de la flexibilité du travail, et au-delà, à sa précarisation. En effet, cette annualisation permettait au patron d’obliger l’ouvrier à travailler jusqu’à 48 heures certaines semaines et de moins travailler d’autres semaines. Cela faisait accepter le principe que l’ouvrier travaille un maximum lorsque le patron en a besoin et ne travaille pas en d’autre temps. Poussé au bout de sa logique, ce principe implique que la plus-value absolue est augmentée quand il travaille, et le salaire annulé quand il ne travaille pas. Là se trouve en gestation ce qui deviendra la « précarité », le rapport de production « précarisé » analysé ci-après. De cette flexibilité du temps de travail à la précarité du travail, il n’y a qu’un pas, ou plutôt c’est la même chose.
– Les accords entreprise par entreprise sur les modalités d’application des 35 heures ont le plus souvent permis aux patrons d’obtenir une suppression des pauses et une densification du temps travaillé, d’organiser la polyvalence des postes et d’obtenir un travail en continu plus intense. D’où une augmentation notoire de la pl absolue en même temps qu’une amélioration du temps d’utilisation des machines, augmentant la productivité (plus-value relative).
– Le financement des 35 heures a été mis à la charge des salariés par le biais, une fois de plus, d’une accentuation du non paiement des charges sociales par les patrons. Les lois Aubry ont ainsi mis à la charge des impôts quelques 10 milliards d’euros annuels d’allègements de cotisations patronales81. Ce procédé pour baisser les coûts salariaux et augmenter la plus-value sera utilisé tant et plus de sorte qu’aujourd’hui, on en est à un minimum d’au moins 30 milliards d’euros d’allègements de charges sociales par an (sans compter l’insuffisance notoire des cotisations pour les retraites). Ainsi, par ce moyen, Sarkozy a réussi à ce que les patrons paient moins cher les heures supplémentaires que les heures normales. « La France est devenue le seul pays de l’Union européenne où les heures supplémentaires sont, pour les employeurs, moins chères que les heures normales (grâce à la suppression de toute cotisation sociale, patronale et salariale) »82. Allonger ainsi la journée de travail avec des heures qui coûtent moins aux patrons, c’est formidable pour augmenter la pl absolue83. Mais cela ne crée aucun emploi supplémentaire, au contraire: « 40 millions d’heures supplémentaires en plus sur un an (en 2008) correspondent à 90 000 postes de travail à temps plein sur le trimestre »84. Et c’est « 3 à 4 milliards d’euros » d’exonérations de charges sociales (de coût salarial) en plus pour les patrons. Le résultat du chemin ouvert par la gauche dans ce domaine aboutit à ce que les déficits dans le budget de l’Etat se creusent (« trou » de la Sécu, dette publique). Ces déficits sont alors brandis comme des preuves qu’il faut rogner encore plus les dépenses sociales de santé, d’éducation, de logement, ainsi que les allocations diverses. En outre, une part de plus en plus grande de l’entretien et de la reproduction de la force de travail est prise en charge par l’Etat. Ce qui est une caractéristique du rapport de production précarisé que nous allons maintenant analyser. Celui-ci indique le sens des principales mesures de fond dont la bourgeoisie va accélérer et accroître la mise en œuvre pour relancer la valorisation du capital.
Le rapport de production précarisé, dont la bourgeoisie développe systématiquement la mise en place dans les pays de l’U.E. (ailleurs, il l’est déjà), répond évidemment à l’objectif d’accroître la pl au détriment du travail nécessaire (ou part de son travail qui revient à l’ouvrier). Mais elle se trouve devant ce problème spécifique de l’époque d’avoir à économiser au maximum sur l’augmentation du capital constant dont nous avons vu que les hauts niveaux atteints en faisaient le principal responsable sur le long terme (structurellement) de la baisse du taux de profit.
Ses efforts dans ce sens ont d’ailleurs déjà porté quelques fruits. Par exemple, en 2002-2004 aux USA, « les gains en terme de productivité du travail… ont été stupéfiants: 4,4 % contre une tendance à long terme de 2,3 % après la seconde guerre mondiale. Plus stupéfiant encore, cette accélération ne vient pas d’une augmentation de plus en plus rapide de l’intensité capitalistique… »85. Il s’agit bien d’une augmentation de l’intensité du travail (pl absolue), de la production par travailleur sans que le capital fixe ait augmenté en proportion. Mais il s’agit aussi dans une certaine mesure d’une hausse de la pl relative car les auteurs ne voient pas que, si l’intensité capitalistique n’a que peu ou pas augmenté en valeur, c’est en partie dû au fait que les prix relatifs des biens d’équipement (leur valeur) ont baissé notoirement. Par exemple, les prix des matériels informatiques ont baissé de 80 %, à qualité égale, de 1998 à 2007. En réalité, il y a eu une certaine augmentation en volume du capital fixe. Aux USA, l’intensité capitalistique est passée de 43 % du PIB en 1996 à 52 % en 200286. Mais de ce fait, elle ne s’est pas traduite autant en valeur, ce qui est idéal pour le capitaliste qui augmente la pl relative en n’investissant que peu ou pas en capital fixe.
Selon un autre auteur: « Le stock de capital fixe des entreprises françaises a culminé à 179 % de la valeur ajoutée en 1982: pour produire 100 F de richesses supplémentaires (cette valeur ajoutée: coûts salariaux + profits bruts, n.d.a.), il fallait disposer au préalable de 179 F sous forme de machines, bureaux, etc. En l’espace d’une décennie, l’intensité capitalistique des entreprises est redescendue, se situant à 155 % en 1996: pour 100 F de valeur ajoutée, on n’a plus besoin aujourd’hui que de 155 F de capital fixe. Soit 13 % de moins qu’en 1982 »87.
Mais observons néanmoins, à propos de ces quelques exemples, que leurs auteurs surestiment la stagnation ou la diminution de la valeur du capital fixe. Cela du fait qu’un certain nombre de ses composantes sont ignorées des statistiques, ou non prises en compte comme afférentes au capital fixe. Tel est le cas, par exemple, du capital « immatériel »: achat des scientifiques, dépenses de travail intellectuel, brevets. Par ailleurs, la diminution de la valeur du capital fixe, lorsque c’est le cas, ne suffit pas à relever le taux de profit. En effet, la valeur des autres éléments du capital constant Cc, tels l’énergie et les matières premières, peut augmenter du fait même de l’accroissement du capital fixe en volume (plus il y a de machines, plus il faut de l’énergie, etc.). Ce qui pousse à augmenter la composition organique Cc/Cv, et donc à diminuer le taux de profit.
Quelle que soit l’approximation de ces chiffres concernant le capital fixe, ils indiquent néanmoins une augmentation significative de l’extraction de la pl sous sa forme absolue. D’ailleurs, l’exemple français permet d’illustrer comment la bourgeoisie modifie systématiquement les rapports de production (sans parler ici des modifications qui interviennent conjointement dans la « superstructure » étatique, juridique et médiatique, tout cela tendant à devenir un même appareil totalitaire) pour parvenir à augmenter cette pl, en accroissant l’intensité du travail horaire fourni et en économisant le plus possible sur Cc. Nous n’examinerons qu’ultérieurement le moyen le plus radical et le plus nécessaire de cette économie, à savoir la destruction massive de capital à quoi procède la crise. Car il s’agit là moins d’un plan conscient de la bourgeoisie que d’un effet qu’elle subit de la concurrence entre capitaux exacerbée par la crise.
Nous en resterons donc pour le moment à l’analyse de ce qui relève de la politique bourgeoise volontaire, organisée par l’état-major de la bourgeoisie, son Etat, concernant la modification des rapports de production dans le sens évoqué ci-dessus. Pour l’exposer, il sera commode de séparer ce qui relève de l’économie de Cc, et ce qui relève de la diminution du travail nécessaire (Cv, les salaires). Mais bien évidemment, les deux aspects sont intimement liés, un certain système de machines et d’organisation de la production induisant toujours un type spécifique adéquat des rapports de production (il n’y a jamais rien de purement technique dans la production).
En ce qui concerne les économies sur le capital constant, on peut en relever de trois types, utilisés depuis longtemps mais dont la mise en œuvre aujourd’hui revêt des caractères très spécifiques.
1°) Economies dans la partie circulante de ce capital, les marchandises entrantes et sortantes. C’est le « zéro stock » et le « flux tendu », le « just in time », la fabrication enclenchée par la vente. Les stocks de produits finaux et de fournitures intermédiaires sont du capital engagé, payé, qui ne rapporte rien, comme toute machine, tout travailleur immobile. Le but est d’obtenir un procès de production souple dont le principe réside dans la « flexibilité », un procès de production devant réagir quasi instantanément aux fluctuations du marché afin de n’engager que les dépenses strictement et immédiatement nécessaires, afin d’immobiliser le moins de capital possible, contrairement aux rigidités de la lourde chaîne fordiste. Tout cela a fait l’objet d’une abondante littérature descriptive de la part des sociologues sur laquelle il n’est pas besoin de revenir ici. Le point essentiel sur lequel nous allons par contre revenir est que cette flexibilité recherchée dans le procès de production conduit directement au travail précaire qui caractérise le rapport de production capitaliste contemporain.
2°) Economies dans la partie fixe de ce capital (machinerie, bâtiments, terrains). L’intensité capitalistique, c’est-à-dire l’importance du capital immobilisé sous forme de moyens de production, rend primordial l’utilisation en continu des machines ou des bâtiments. Toute immobilisation coûte fort cher, c’est une masse de capital qu’il faut quand même amortir et dont il faut, par exemple, rembourser les crédits. D’autant plus qu’avec le « zéro stock », un arrêt d’une machine dans la chaîne des opérations aboutissant au produit fini peut suffire à immobiliser toutes les machines de cette chaîne. D’où l’importance non seulement du « zéro panne » afin que les machines soient utilisées en permanence, mais aussi du « zéro défaut » afin que tout ce temps soit un temps de production utile et non de pièces à mettre au rebut. Cet objectif du zéro défaut induit notamment une plus forte simplification du travail, ce qui facilite aussi la polyvalence des ouvriers. En outre, il nécessite un travail minutieusement prescrit et plus rigoureusement contrôlé. L’informatique est d’une grande utilité à cet égard car elle facilite le « one best way » taylorien perfectionné à l’extrême. Il nécessite aussi des ouvriers pas trop fatigués, dociles, « impliqués » (ils seront appelés « équipiers », « associés », le groupe sera appelé à contrôler lui-même ses membres par le biais de diverses récompenses). L’usage de moyens de production « just in time » implique évidemment que des salariés soient disponibles la nuit, le dimanche88, mais seulement le temps nécessaire, de façon flexible.
3°) La sous-traitance. Le but de la sous-traitance est de se débarrasser du capital constant en en faisant supporter le fardeau, en tout ou partie, à d’autres89. Dans des cas extrêmes, cela peut aller jusqu’à « l’entreprise sans usine », la société mère ne conservant que les activités supérieures qui lui permettent de conserver la maîtrise sur les sous-traitants et de s’approprier l’essentiel de la pl produite chez eux. L’accumulation financière reste ainsi dans les grands centres. Dans les pays de sous-traitance, l’extorsion de la plus-value est maximum, combinant tous les moyens: chaîne taylorisée au maximum, longueur de la journée de travail, absence de congés, forte productivité, bas salaires, conditions de travail quasi esclavagistes.
Observons que la flexibilité ne supprime pas la chaîne tayloriste-fordiste. Elle l’assouplit en la segmentant en « cellules » qui sont localisées dans le monde et organisées en fonction du type d’opérations qui leur sont confiées. Ainsi, elles n’ont pas la rigidité qu’avaient les anciennes chaînes fordistes organisant en un bloc compact tout un long procès de production. Cette segmentation permet aussi de briser les grandes concentrations ouvrières qui constituaient de facto une force imposante face aux patrons. Elle organise une sorte de chaîne taylorisée à l’échelle mondiale et maintient le principe fordiste du « flux continu », mais avec toute la souplesse que permet la diversification des sous-traitants. Les uns sont choisis pour des fabrications simples avec main d’œuvre bon marché; d’autres le sont pour leurs qualifications (l’informatique « externalisée » à Bangalore en Inde par exemple), d’autres pour leur situation géographique à proximité du marché par exemple. Tous sont mis en concurrence pour qu’ils travaillent aux plus bas coûts, pouvant aisément être remplacés par d’autres quand ils ne donnent pas satisfaction aux donneurs d’ordres. Ainsi, la précarité est partout. Cette organisation d’une chaîne hyper-taylorisée, mais mondialement segmentée, est typique de l’impérialisme moderne et de sa division du travail. C’est la 3ème phase de la mondialisation capitaliste90.
Tout ce qui vient d’être analysé en ce qui concerne les économies de capital constant va se répercuter en ce qui concerne la diminution du travail nécessaire (Cv) par l’augmentation de l’intensité du travail et par sa flexibilisation-précarisation. Mais comme cela s’avèrera insuffisant, il faudra y ajouter une prise en charge grandissante du coût de l’entretien et de la reproduction de la force de travail par l’Etat. Autrement dit, une baisse du coût salarial pour l’entreprise, qui s’ajoute à la baisse du salaire réel (salaire nominal déflaté), et qui augmente d’autant la pl. Nous verrons que cette caractéristique est hautement significative de l’ampleur des difficultés que le capital à son âge sénile doit résoudre pour poursuivre son existence, son procès de valorisation.
Choisir d’augmenter l’intensité du travail prolétaire tout en diminuant son temps de travail, et donc son salaire, correspond à une situation où l’intensité capitalistique est forte. Pour compenser ce handicap pour le capital, il faut que la machinerie, le travail mort (passé) consomme et transfert au produit le maximum de travail vivant dans un même temps. Augmenter l’intensité du travail correspond à cet objectif. Pour ce faire, on soumettra le prolétaire au contrôle rigoureux d’un travail minutieusement prescrit et on s’efforcera de supprimer jusqu’au moindre temps mort dans ses gestes afin qu’il travaille plus vite. Ces moyens sont connus et appliqués depuis Taylor. Ils induisent la plus grande simplification et la segmentation du travail et sont aujourd’hui « perfectionnés », systématisés et amplifiés grâce à l’informatique. Mais, comme dans de nombreux postes de travail, une large part du temps consiste à surveiller la machine, le capital développe aussi la polyvalence des tâches. L’ouvrier travaillera donc sur plusieurs machines à la fois et sur plusieurs postes différents91. Toujours plus de flexibilité! Désormais, il doit être encore beaucoup plus que cela. Il doit accepter de travailler intensément quand le capital en a besoin, et d’être immédiatement rejeté lorsqu’il n’en a plus besoin. Il doit être totalement disponible aux besoins du capital. Il doit subir une alternance perpétuelle de périodes de travail intense et de non travail, un déplacement de lieux au gré des mouvements du capital. Il doit subir les effets de la segmentation mondiale du procès de production évoquée ci-dessus (les fameuses délocalisations). Le travail ainsi intensifié, segmenté, intermittent, aléatoire, ne lui procurera pas un surcroît de salaire. Bien au contraire, celui-ci sera diminué et aléatoire. C’est là une partie de ce que désigne la notion de travail précaire92, ou de rapport de production précarisé. Nous compléterons le contenu de cette notion plus loin.
Ce rapport précarisé est celui que tend à systématiser, et renforcer, la bourgeoisie comme moyen d’augmenter la production de plus-value93. Il présente plusieurs avantages pour les entreprises à forte intensité capitalistique dont on peut maintenant donner un premier résumé:
1°) Le travail précarisé, c’est non seulement le travail intermittent, mais aussi la multiplication des emplois à temps partiels, tout cela générant des salaires partiels. Les « working poors », travailleurs pauvres, voient leur nombre croître.
2°) Le travail court est adéquat à la recherche du maximum d’intensité et de qualité du travail; le rendement du prolétaire est toujours plus élevé dans les premières heures. « Comment le travail est-il rendu plus intense? Le premier effet du raccourcissement de la journée du travail procède de cette loi évidente que la capacité d’action de toute force animale est en raison inverse du temps pendant lequel elle agit. Dans certaines limites, on gagne en efficacité ce qu’on perd en durée »94. On a vu que tel était déjà un des objectifs atteint des lois Aubry sur les 35 heures. Ce gain d’efficacité augmente le taux de pl (d’exploitation). Par exemple, à salaire horaire égal, le temps de travail et le salaire peuvent être divisés par deux, mais la quantité de travail vivant fourni pendant ce mi-temps est supérieure à la moitié de la quantité du même travail qui aurait été fourni à plein temps. A intensité de travail différente, le même temps de travail ne fournit pas la même quantité de travail, ce gain est donc du surtravail (pl).
3°) Mieux vaut donc en général pour un capitaliste, deux ouvriers travaillant chacun quatre heures qu’un huit heures. De plus, si l’un d’eux vient à manquer, l’autre peut être immédiatement appelé à le remplacer. Ou si la production doit ralentir, l’un d’eux pourra être renvoyé immédiatement. De même, l’usage massif des intérimaires constitue un volant de sécurité, réducteur de risque. A production « just in time », travail « just in time ». Si on ne peut empêcher l’arrêt des machines, au moins qu’on économise sur tout le capital circulant: zéro stock d’intrants, zéro stock de produits finis, zéro stock d’ouvriers. Au moins avec tous ces zéros, le capitaliste n’aura à supporter que l’immobilisation du capital fixe (ce qui pour lui est déjà beaucoup)95.
4°) Le rapport de production précarisé est une réponse du capitalisme au phénomène de la réduction de la quantité de travail vivant prolétaire qu’il peut employer pour une production donnée. Il en tient compte à sa façon: a) en raccourcissant le temps de travail prolétaire, b) en en profitant pour augmenter l’intensité horaire, c) en présentant tout cela comme des mesures « pour l’emploi », une façon à lui de partager le travail prolétaire tout en le rendant plus productif. La cerise sur le gâteau: il pourra faire croire qu’il diminue le chômage.
De sorte que le rapport de production précarisé apparaît comme le rapport de production idéal pour les capitalistes et leurs porte-paroles. Ils argumentent que c’est la seule façon de permettre aux « entreprises » (pour ne pas dire aux capitalistes) d’embaucher plus: il y en a tant, n’est-ce pas, prêts à travailler aux plus bas prix. Cela leur reviendrait « trop cher » d’employer une main d’œuvre stable, un peu protégée des licenciements par quelques droits. Avec un culot monstre, ils accusent ainsi les prolétaires qui défendent leurs maigres droits et revenus d’empêcher l’embauche, d’être responsables du chômage! Quand on pense aux pharaoniques salaires, indemnités de départ, stock-options, bonus et autres retraites chapeau qu’ils s’octroient, on ne peut que se dire que la reine Marie-Antoinette était bien moins cynique qu’eux lorsqu’elle répondait au peuple affamé et venant lui demander du pain: « si vous manquez de pain, mangez de la brioche! » Qui sait alors le sort qui leur sera réservé aux jours de la colère? Quoi qu’il en soit, leur conclusion est formelle: « La priorité aujourd’hui, c’est de donner à la fois plus de souplesse aux entreprises et plus de sécurité aux salariés pour aller enfin vers cette fameuse flexsécurité… »96. « Flexsécurité » est le mot qu’ils donnent au rapport de production précarisé.
Pour la souplesse, la flexibilité, les choses avancent à grands pas. En France par exemple, « près de 2 salariés sur 3 travaillent avec des horaires atypiques, que ce soit de nuit, le week-end, à temps partiel ou à des périodes imprévisibles ou décalées »97.
Pour la sécurité, le mot est là pour tromper. Il s’agit en réalité de l’intervention de l’Etat pour assurer la survie des prolétaires « employables », précarisés, en complétant leurs salaires intermittents. Au mieux, cette sécurité relève du misérable RMI ou se présente comme l’augmentation exponentielle du nombre des « working poors ». Même au Japon, pays autrefois réputé pour « l’emploi à vie », « un tiers des employés japonais sont aujourd’hui des travailleurs temporaires »98. Il en va de même en France, « aujourd’hui, environ un tiers des salariés est à « temps non complet » alors que ce pourcentage s’élevait à 18 % en 1978 »99.
Une fois compris que le rapport de production précarisé permet d’augmenter le taux d’exploitation, on doit constater que les limites rencontrées par le capital pour y parvenir sont telles (nous verrons pourquoi au point 5.3 ci-dessous) qu’elles ne lui permettent pas de relever le taux de profit à un niveau lui permettant de retrouver une dynamique d’accumulation quelque peu vigoureuse. D’où l’antienne martelée jour après jour: « la seule variable d’ajustement possible pour les entreprises (entendez le capital, n.d.a.) consiste à réduire (les coûts salariaux)… (ce qui) appelle une solution commune: la baisse globale des charges et des prélèvements obligatoires. Aujourd’hui (en France), les salaires n’entrent en effet qu’à hauteur de 60 % dans la composition du revenu brut des ménages… »100. 40 % de ces revenus, et bien plus pour les ménages modestes, sont faits de salaire indirect. C’est dire l’importance qu’il revêt pour le pouvoir d’achat de ces ménages. Et comme il est plus facile d’abaisser ces charges payées par les entreprises que les salaires directs, c’est par là que la bourgeoisie a décidé d’abaisser le coût salarial, « seule variable d’ajustement » pour augmenter les profits selon elle avec, bien sûr, les diminutions d’impôts sur les sociétés. Alors, le patronat, ses experts et ses médias, adjurent l’Etat – après tout c’est le leur – de poursuivre et d’accentuer le processus d’allègement des charges et des impôts sur les sociétés, qui a été initié par les gouvernements de gauche dans les années 80. Pensez donc, « il reste encore 20 % de cotisations patronales sur un SMIC brut »101 gémit l’un de ces experts!
Et l’Etat ne peut manquer d’obtempérer, lui dont la tâche est d’organiser la valorisation du capital, tout en maintenant l’ordre social, afin de reproduire la société capitaliste dont il a la charge. Les mêmes arguments sont sans cesse ressassés: pour que le capital produise, croisse et embauche, il faut briser la « barrière », le « fardeau » de ces charges et du droit du travail, toutes choses, disent-ils, qui « obligent » les capitalistes à délocaliser. Les charges seront donc abolies pour les patrons, les diverses allocations sociales, l’éducation et la santé « dégraissées » selon la formule du ministre socialiste Allègre. Par contre, la fiscalité des particuliers sera aggravée.
Cette politique d’allègement des charges patronales sera couplée avec celle qui organise le rapport de production précarisé. Toujours sous prétexte de favoriser l’emploi, les exonérations de charges seront plus spécialement accordées aux entreprises développant le temps partiel. C’est encore un ministre de gauche, Bérégovoy qui, en 1992, porte à 50 % l’exonération de charges sociales pour l’emploi de salariés à temps partiel. Cette politique s’est depuis sans cesse amplifiée, jusqu’au récent « revenu de solidarité active » (RSA) sarkozyste. Celui-ci va encore au-delà de l’exonération des charges puisque, tout en favorisant fortement l’emploi à temps très partiel, il met carrément à la charge de l’Etat le paiement d’une partie du salaire, ce qui permet au patron de diminuer sa part de salaire direct en plus de celle du salaire indirect.
Avec ce RSA, on a une systématisation de l’emploi précaire, sous-payé, et payé en partie par l’Etat. Le procédé existait déjà avec les diverses formes « d’emplois aidés », mais la participation de l’Etat au salaire était temporaire tandis qu’avec le RSA, elle est pérenne. Bref, on voit se développer une autre caractéristique essentielle du rapport de production précarisé et qui est rarement prise en considération et analysée. C’est la forte accélération de la tendance à la prise en charge par l’Etat102 de l’entretien et de la reproduction de la force de travail prolétaire. Il assure une part grandissante du revenu prolétaire, via le salaire indirect et même le salaire direct, tout en les faisant diminuer, tant par la dégradation des prestations sociales, des systèmes de santé et d’éducation, qu’en augmentant les impôts que paient même les prolétaires pauvres. Par exemple, en France, la CSG-CRDS passe de 0 à 12,1 % en une vingtaine d’années pendant que la contribution patronale « au financement de la protection sociale est passée de 44 % du total en 1981 à 37 % en 2006 », alors que pendant la même période, « les cotisations salariales ont augmenté de 5 points »103. L’Etat assure a contrario une part grandissante de la pl104.
On est donc loin du soi-disant désengagement de l’Etat dont la gauche nous rebat les oreilles. C’est tout le contraire. On a vu son ampleur en ce qui concerne le sauvetage du système financier et des entreprises du secteur marchand. On le voit maintenant dans cette restructuration des rapports de production, et notamment, dans cette prise en charge d’une part croissante du revenu prolétaire, c’est-à-dire dans l’entretien et dans la reproduction de la force de travail prolétaire. Nous devons donc analyser quels sont les effets de ce phénomène sur la « sortie de crise », et surtout quelle est sa signification quant à la situation dans laquelle le capitalisme se trouve. Mais auparavant, il n’est pas inutile de dire en quoi le rapport de production préconisé modifie le rapport salarial, la vente de la force de travail.
Fluidité, flexibilité, intensité, ces caractéristiques du rapport de production produisent le prolétaire comme précaire et pauvre face au capital sur-accumulé vampirisant l’essentiel des richesses produites. Le rapport de production précarisé est généralement reconnu en tant que contrats de travail spécifiques (intérim, CDD, temps partiel, contrats professionnels, d’apprentissage, de Nouvelle Embauche, etc.) dont les statistiques établissent le rapide accroissement. Mais premièrement, le fond de l’affaire n’est pas là, sur le terrain juridique. Ce type de contrats se généralise parce que l’emploi en général, l’emploi « normal », bref, le travail prolétaire, doit prendre concrètement les caractéristiques de l’emploi précaire: un ou plusieurs emplois à temps partiels, payés partiellement, alternance de temps de travail intense et déqualifié (avec toutes les souffrances qui vont avec) et de non travail. La vente de la force de travail inclut tous ces temps, le temps de non travail n’est plus séparé mais comme inclut dans le temps de travail au sens où il fait partie du rythme du travail segmenté et intermittent. Et deuxièmement, l’autre caractéristique est que l’Etat prend en charge une partie grandissante du paiement de ce temps global, tout en en diminuant le montant au strict minimum vital, voire moins.
Après avoir montré les caractéristiques du rapport précaire, on peut maintenant en résumer les effets en trois points principaux:
1°) La pl absolue est augmentée par la concentration et l’intensification maximale du temps de travail sur certaines périodes alternant avec des périodes de non travail. Cette alternance constitue un temps global dont font partie les temps de pause, de congés, de chômage partiel, de maladie, temps pendant lequel le travailleur appartient au capital105. La « flexsécurité » est le nom que la bourgeoisie donne à cette globalisation du rapport prolétaire-capital. Il y a une corrélation entre ce rapport et l’intervention accrue de l’Etat dans la gestion de la « flexsécurité », dans le fait qu’il est le représentant, l’agent du capital global. Aujourd’hui, l’intérêt de chaque capital particulier, son profit, est plus que jamais directement dépendant des conditions générales de la valorisation du capital, lesquelles sont l’affaire de l’Etat. A capital globalisé (suite à l’extinction de la propriété privée personnelle des moyens de production et à la concentration oligopolistique), gestion globalisée par le fonctionnaire du capital en général, l’Etat106. De sorte que les prolétaires ont face à eux le capital moins comme patrons particuliers que comme un maître global, totalitaire, l’Etat. C’est plus que jamais contre l’Etat qu’ils pourront se constituer comme classe révolutionnaire, et non en s’affrontant localement à tel ou tel capitaliste particulier.
2°) La plus-value est aussi augmentée par la baisse du coût salarial pour le capitaliste. L’Etat finance cette baisse pour une part. En France, par exemple, par l’allégement des charges sociales et prélèvements obligatoires, et en se chargeant de payer une part grandissante du revenu ouvrier qu’il diminue dans le même mouvement en favorisant le travail précaire et en diminuant le montant et la qualité des prestations sociales. Ainsi, l’entretien et la reproduction de la force de travail sont de plus en plus assurés par l’Etat, tandis que l’usage de cette force et son produit restent aux mains des capitalistes particuliers. Par le biais de l’augmentation de la dette publique et des impôts, c’est finalement le travailleur contribuable qui subventionne la baisse croissante du coût du travailleur salarié dont bénéficie le capitaliste. Ce qui est non seulement un comble de l’exploitation et de la paupérisation, mais une impasse évidente (cf. infra).
3°) Le travail précaire se traduit finalement par une augmentation massive du nombre des travailleurs pauvres (qui s’ajoute à celle des « exclus » définitifs du marché du travail).
Plus le capitalisme est capable de produire des richesses matérielles (on ne discutera pas ici de leur utilité) et plus se développe la pauvreté, non seulement relativement à la richesse produite, mais de manière absolue. C’est une loi du capitalisme depuis longtemps découverte par Marx: « Plus le travail gagne en ressources et en puissance… plus la condition d’existence du salarié, la vente de sa force, devient précaire… C’est cette loi qui établit une corrélation fatale entre l’accumulation du capital et l’accumulation de la misère… »107. Loi qu’aucune prétention à établir un « bon capital » ne peut transgresser puisqu’elle est inhérente à l’essence du capital, le rapport d’appropriation privée. Le rapport de production précarisé n’est que ce rapport capitaliste poussé à son comble pour faire face à l’aggravation des contradictions du procès de valorisation et de reproduction du capital. Mais cela ne les abolit pas pour autant. Au contraire, notamment celles-ci: l’antagonisme bourgeoisie-prolétariat et la baisse de la consommation.
Cependant, malgré tous ces efforts intenses pour développer ce rapport de production précaire depuis maintenant plus de vingt ans, les crises se sont multipliées jusqu’au grand krach de 2008. La bourgeoisie va donc être obligée de les intensifier. Or elle se heurte à des limites pour augmenter, par le développement de ce rapport, l’extraction de la pl sous sa forme absolue. Or, comme on l’a déjà vu, augmenter la pl sous son autre forme, la pl relative, se heurte aussi à des limites: ce sont précisément celles qui ont obligé la bourgeoisie à développer le rapport de production précaire, ainsi que cela a été montré précédemment. C’est pourquoi, cette situation va l’obliger à amplifier l’autre volet de sa solution à la crise: la destruction du capital sous toutes ses formes. Nous disons amplifier parce que la crise produit déjà d’elle-même et « naturellement » cette destruction.
5.3 Etatiser pour détruire
L’accroissement de l’intensité du travail qui est recherchée avec le rapport de production précaire a des limites physiques objectives même s’il est réduit à un travail très simple ou de simple surveillance. C’est alors le « stress » qui se développe avec le nombre de machines et d’opérations à surveiller, la peur de la faute et du licenciement, et aussi le mortel ennui. De plus, il ne résout en rien le problème de la sous-consommation. Au contraire, il s’agit toujours de diminuer la masse salariale (Cv) relativement à celle de pl, tout en augmentant la production et l’accumulation du capital. Le fond des difficultés du capital à accroître la plus-value, que ce soit sous forme relative ou sous forme absolue, à une époque de son développement où l’intensité capitalistique a atteint des niveaux très élevés, peut se résumer à ceci: cet accroissement est beaucoup plus difficile à obtenir quand l’exploitation accrue, qui en est le moyen, ne porte plus que sur une quantité de travail prolétaire devenue très faible dans la valeur produite, et que le perfectionnement incessant des méthodes tayloristes d’Organisation Scientifique du Travail a porté le taux d’exploitation de ces prolétaires à un niveau difficile à dépasser. Et quand, plus généralement, les autres contre-tendances à la baisse du taux de profit ont touché également leurs limites.
Il faut d’abord observer que la diminution relative de la quantité de travail prolétaire s’étend partout, y compris dans des pays, comme la Chine ou l’Inde, où on a connu ces 20 dernières années un accroissement important du nombre de travailleurs, extraits des campagnes et transformés en prolétaires par le capital mondialisé venu chercher les coûts salariaux les plus bas. En effet, ces pays se sont industrialisés selon les moyens techniques les plus modernes, et l’intensité capitalistique s’y est rapidement rapprochée de ce qu’elle est dans les pays les plus avancés. Ainsi en Chine, la « fabuleuse croissance » est due selon les estimations pour 62 % à la croissance du capital fixe, « la part de l’augmentation de l’emploi est donc devenue très faible »108. De même, en Slovénie, un directeur de l’usine d’assemblage Renault explique que la main d’œuvre y est certes trois fois moins chère qu’en France, mais qu’elle ne représente que 15 % « du prix de revient d’une auto – ce faible coût étant également vrai pour nos équipementiers »109.
Bien évidemment, il n’y a pas que ces difficultés objectives. On sait le rôle que la résistance ouvrière, par exemple en mai-juin 68 en France, a joué pour détruire le rapport de production fordiste. Et la formidable aggravation de la condition prolétaire que le développement accéléré du rapport de production précarisé produit, suscitera tôt ou tard une résistance plus forte encore, sortant du train-train syndical ou de l’impasse des luttes émiettées. Mais pour ne rien prophétiser et en rester sur le terrain des difficultés objectives que rencontre la bourgeoisie pour valoriser et reproduire le capital, et avec lui, la société capitaliste, il faut généraliser notre analyse et constater l’épuisement de l’ensemble des contre-tendances110 à la baisse du taux de profit qu’elle a pu mettre en œuvre ces vingt dernières années.
On connaît les trois principales:
– l’augmentation du taux d’exploitation par la précarisation du rapport de production;
– la mondialisation (3ème phase) qui a permis l’extension des échanges et de la production mondiale, tout en contribuant à la baisse des coûts salariaux;
– l’hypertrophie du crédit qui a dopé cette extension, notamment en soutenant artificiellement la consommation dans les pays centraux, les principaux consommateurs.
La crise actuelle marque la fin des effets « bénéfiques » de ce système contre-tendanciel qui a été appelé libéralisme. Il répondait à la crise du système fordiste ouverte dans les années 70 qui manifestait les limites rencontrées à l’accroissement de la pl sous sa forme relative. La bourgeoisie y a répondu, comme nous l’avons montré ci-dessus, par une intense offensive pour accroître la pl sous sa forme absolue et pour abaisser les coûts salariaux. Mais il n’y a pas d’autres modes d’extraction de la pl que ceux là. Qu’ils s’épuisent marque bien le caractère sénile du capitalisme. A cela, le dopage massif par le crédit n’a apporté qu’une rémission provisoire ainsi qu’on peut le constater par l’effondrement du système financier. Quant aux effets « bénéfiques » de la mondialisation, ils s’épuisent également. La poursuite des baisses des coûts de production se heurte à des salaires déjà extrêmement bas et à des révoltes contre la misère, contre l’impérialisme, et contre les graves dégâts écologiques que la bourgeoisie doit prendre en compte, au moins dans la mesure où elle peut en être elle-même victime tant qu’elle vit sur la même planète que les prolétaires.
Ce sombre tableau ne signifie pas pour autant que le capitalisme va s’effondrer tout seul. Il montre seulement que les moyens mis en œuvre jusqu’ici ne suffisent pas à relancer la valorisation du capital de manière assez vigoureuse. D’où l’engagement des principaux Etats pour sauver le système financier à coups de milliers de milliards de dollars et pour fournir au capital la plus-value qu’il réclame. Ce n’est que la prolongation d’une tendance ancienne, mais l’ampleur prise par cette évolution mérite qu’on caractérise spécifiquement ce phénomène. Il n’est pas anodin en effet que dans un pays développé comme la France, l’Etat fournisse environ la moitié du – très modeste – revenu prolétaire moyen.
C’est parce que chaque capital particulier peine à réaliser un taux de profit suffisant que l’Etat se comporte de plus en plus comme « le » capitaliste, « le » fournisseur de plus-value.
Il le fait en abaissant les impôts sur le capital et les capitalistes. Il le fait en déchargeant les capitalistes (surtout ceux qui favorisent l’emploi précaire) d’une partie du coût salarial. Mais là n’est pas le plus important. Il fiscalise le revenu prolétaire: il le diminue aussi. Premièrement, en augmentant leurs impôts, et qui augmenteront encore plus avec le creusement de la dette publique à laquelle ces faveurs faites au patronat contribuent. Deuxièmement, en diminuant le salaire indirect et en dégradant les services publics au nom de cette même dette publique (« trou » de la Sécurité sociale, « trou » des caisses indemnisant le chômage, « trou » des caisses de retraite, etc.). Troisièmement, par l’inflation monétaire que cette dette gigantesque engendrera.
En devenant « le » capitaliste, l’Etat organise la baisse du niveau de vie prolétaire. Mais il camoufle cette activité derrière l’idéologie de l’intérêt général dont il se prétend le représentant. Ne va-t-il pas jusqu’à soutenir qu’il favorise l’emploi en abaissant le coût salarial des emplois les moins qualifiés, que cette baisse favorisant l’emploi favorise en même temps la reprise de la croissance? Dans les conditions du capitalisme, cela peut s’avérer exact, quoi que momentanément et dans d’étroites limites. Mais ce serait dans l’intérêt du capital et de ses fonctionnaires, et non dans l’intérêt général.
L’Etat comme « le » capitaliste se substituant à l’Etat des capitalistes, on se croirait presque en route vers un régime de capitalisme d’Etat de type stalinien. Mais ce n’est pas du tout la même situation historique. L’Etat stalinien a puissamment organisé une sorte « d’accumulation primitive », à très grande vitesse. Dans les vieux pays impérialistes comme la France, il n’y a rien de cela, mais au contraire une accumulation arrivée à un stade sénile, gâteuse dans tous les sens du terme.
Cela fait penser à cette formulation quelque peu énigmatique de Marx et Engels dans le Manifeste du Parti Communiste: « Elle (la bourgeoisie) ne peut plus régner, parce qu’elle est incapable d’assurer l’existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu’elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui ».
Enigmatique parce qu’évidemment, la bourgeoisie n’existe qu’en se nourrissant du travail prolétaire. Marx le sait bien puisque c’est lui qui l’a établi définitivement. C’est pourquoi, il précise que si la bourgeoisie n’y parvient plus, c’est qu’elle ne peut plus régner. Et il en a établi la cause dans ses travaux ultérieurs: dans les sociétés hautement mécanisées, les prolétaires ne produisent plus assez de cette plus-value qui la nourrit. Dès lors, elle ne peut plus non plus les employer. Et eux ne peuvent plus se nourrir de leur « travail nécessaire » puisque leur revenu n’est plus assuré par les possesseurs des moyens de production. En effet, c’est la production de plus-value qui décide de leur emploi et rien d’autre. Dire que la bourgeoisie doit nourrir les prolétaires est un oxymore puisque ce ne peut être que l’inverse. Ce qui est certain, c’est « qu’elle est obligée de les laisser déchoir ». Et ce qui aurait pu être dit, et que Marx dira plus tard, c’est que les machines hautement perfectionnées, et derrière elles, la science, peuvent nourrir les travailleurs, quand bien même ils travailleraient très peu… si du moins elles ne revêtaient pas la forme de capital, c’est-à-dire si les travailleurs collectivement en avaient la possession.
Pour en revenir à notre propos, on voit que l’évocation de « l’esclave » nourri par la bourgeoisie est une formule qui se rapproche du phénomène de « l’esclave » nourrit par l’Etat, la bourgeoisie organisée, dont nous avons vu la tendance se développer. Mais le parallèle s’arrête là, car c’est en aggravant les impôts sur le peuple ainsi que la dette publique qui pèse et pèsera toujours davantage sur lui, que l’Etat le nourrit précairement comme un RMIste ou un « working poor ». Dans le même mouvement, il abreuve le capital de liquidités et de profits supplémentaires. Ce système mène à une impasse car il revient, poussé à sa limite, à ce que « l’esclave » n’ait plus de revenu et que la consommation s’effondre, effondrant davantage la production de pl qu’on voulait par là augmenter. Lorsque l’essentiel de la richesse est produite par les machines automatisées et que celles-ci sont possédées par la bourgeoisie, alors c’est cette dernière qui se l’approprie nécessairement. En poussant la tendance de l’accumulation du capital au plus loin qu’elle peut, la bourgeoisie, qui possède les moyens de production, ne peut plus les faire fonctionner faute de pl, les prolétaires ne le peuvent pas non plus faute d’en être possesseurs. Voilà l’impasse criminelle et stupide où mène le capitalisme!
On doit donc aboutir à la conclusion que l’ensemble des moyens mis en œuvre par la bourgeoisie pour surmonter la crise évoqués jusqu’ici, depuis le sauvetage du système financier jusqu’au développement du rapport de production précarisé et l’intervention renforcée de l’Etat dans la production de la plus-value, ne sont que des solutions de court terme, insuffisantes pour résoudre le problème de la suraccumulation/sous-consommation qui est la cause immédiate de la crise, la cause ultime étant ce qui engendre ce processus: le rapport d’appropriation privée des moyens de production. C’est pourquoi, la bourgeoisie devra nécessairement attaquer de front ce problème en opérant une destruction de capitaux excédentaires et fictifs, bien au-delà de celle que la crise induit « naturellement » avec son cortège de dévalorisations, de faillites et de fermetures d’entreprises.
« Le stade suprême du développement de la puissance productive ainsi que le plus grand accroissement de la richesse jamais connue coïncident donc avec la dépréciation du capital, la dégradation du travailleur et l’épuisement systématique de ses capacités vitales. Ces contradictions conduisent à des explosions, des cataclysmes, des crises dans lesquelles, par la suspension momentanée du travail et la destruction d’une grande partie du capital, ce dernier est ramené par la violence à un niveau où il peut reprendre son cours »111.
Mais le capital n’est pas seulement « ramené à un niveau » antérieur, résolvant le seul problème quantitatif des surcapacités. La suraccumulation n’est pas seulement une surcapacité. La surmonter exige aussi des mesures qualitatives que nous avons exposées ci-dessus. Les mettre en œuvre exige évidemment la destruction des anciens rapports de production. La destruction de ces rapports va de pair avec celle des surcapacités. Tant par le chômage accru qu’elles impliquent, qui induit une forte pression sur des prolétaires encore sur la défensive, que par la fermeture des entreprises trop obsolètes, les destructions des surcapacités permettent d’une part, de remplacer l’ancien par le neuf, les entreprises les moins performantes par de plus performantes112 et d’autre part, de transformer toute l’organisation de la production, de casser les acquis sociaux. La destruction massive de capital fait donc en quelque sorte d’une pierre deux coups: elle réduit les surcapacités, elle permet aux entreprises de sortir de la crise autrement qu’elles y étaient entrées, avec des rapports de production modifiés qui permettent d’augmenter le taux d’exploitation et le taux de profit.
Tout cela exige un renforcement conséquent de la dictature de l’Etat. Il est nécessaire pour imposer aux prolétaires l’aggravation de leur situation. Mais il est aussi nécessaire parce que l’ampleur des destructions à réaliser implique une très vive aggravation de la concurrence entre capitaux, chacun déployant tous ses efforts pour que ce soit les autres qui disparaissent. Vaincre dans cette concurrence exige notamment d’organiser une défense plus collective des divers capitaux nationaux, déclarés « stratégiques » pour l’occasion. Chaque Etat s’empresse d’organiser cette défense, tant sur les plans économique (protectionnisme) que militaire. Mais il le fait dans le contexte de la mondialisation, dans le système planétaire du procès d’extraction de la pl. Ce niveau de la concurrence implique la formation d’alliances plus ou moins solides, de blocs plus ou moins stables113. Aucun Etat, pas même les USA, ne peut assurer seul sa place dans cette compétition planétaire qui met en jeu des forces énormes et complexes (rivalités entremêlées entre capitaux, nations, classes et intérêts spécifiques pour tels marchés ou zones d’influence; alliances qui incluent aussi des rivalités entre alliés, etc.)114.
Cette concurrence internationale a évidemment parmi ses divers enjeux celui de la domination des pays plus faibles, producteurs des matières premières indispensables aux plus puissants. Et c’est là, dans la capacité à s’approprier le maximum de ces ressources et à évincer les concurrents, que se montre la puissance. C’est là que la force militaire et les guerres se déploient d’abord. Déjà en 1914, il s’agissait du partage des colonies. La concurrence ne fera que s’accroître, particulièrement pour savoir qui pillera le plus les ressources du « Tiers Monde ». Cela se passe déjà tous les jours sous nos yeux.
Plus généralement, la puissance des grands centres de l’impérialisme tient en leur capacité économique et militaire à capter le plus de richesses produites mondialement. C’est d’ailleurs pourquoi, ce sont des centres financiers et des puissances militaires. C’est cette capacité qui fait que le dollar et les Bons du Trésor US restent encore les titres les plus recherchés, alors même que c’est le système financier américain qui est au cœur de la débâcle et que l’émission de dollars atteint les montants les plus pharamineux.
Il n’est donc pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que cette crise entraînera un fort renforcement de la dictature de l’Etat (on en voit déjà la tendance en France avec le sarkozysme). Malgré l’aiguisement objectif de l’antagonisme bourgeois-prolétaires, l’Etat trouvera des bases pour obtenir le soutien d’une partie plus ou moins importante des masses populaires dans le fait que cette concurrence accrue entre capitaux en difficultés induit aussi une concurrence accrue entre travailleurs pour la vente de leur force de travail, leurs intérêts individuels immédiats, ou ce qu’ils croient l’être. A partir de là, les idéologues et propagandistes du capital peuvent exciter et développer, à l’aide des puissants moyens médiatiques qu’ils possèdent, ces tendances à l’étatisme, au protectionnisme, au nationalisme et à la xénophobie.
Il serait tout à fait impossible d’éviter l’écrasement des prolétaires et des peuples du monde, ainsi que les massacres et les catastrophes pouvant aller bien au-delà de ce que le monde a connu dans les années 30-45, sans combattre et refuser fermement tout ce fatras étatiste nationaliste et européocentriste. C’est exactement cette idéologie délétère qui a conduit de trop larges fractions de la gauche et des peuples à soutenir, ou à tout le moins, à tolérer la montée au pouvoir des fascismes dans les années 30.
Nous venons de voir dans ce chapitre que le renforcement du rôle de l’Etat dans la crise ne produisait que destructions et catastrophes non seulement pour les prolétaires mais aussi pour les masses populaires. Mais si la crise ne se résout que par des destructions, pourquoi ne pas choisir de détruire le capitalisme? On le peut, et il le faut car c’est le seul « humanisme » vrai aujourd’hui. Il faut alors comprendre que ce qui pousse le capital à devoir détruire tant de richesses et tant d’individus contient aussi les conditions de la destruction du capital, de l’abolition de l’appropriation privée des moyens de production. Cette crise révèle combien ces conditions sont mûres. Il revient aux communistes de travailler à le faire voir le mieux possible afin de montrer que ce qui conduit aux pires catastrophes dans le cadre d’un capitalisme « rénové », peut conduire à une communauté d’individus libres dans un système où les prolétaires prendraient le pouvoir et s’émanciperaient de l’exploitation et de la domination bourgeoises.

