THÈSES SUR LA SITUATION CONTEMPORAINE
Publié par admin on Déc 17, 2014 | 0 commentaire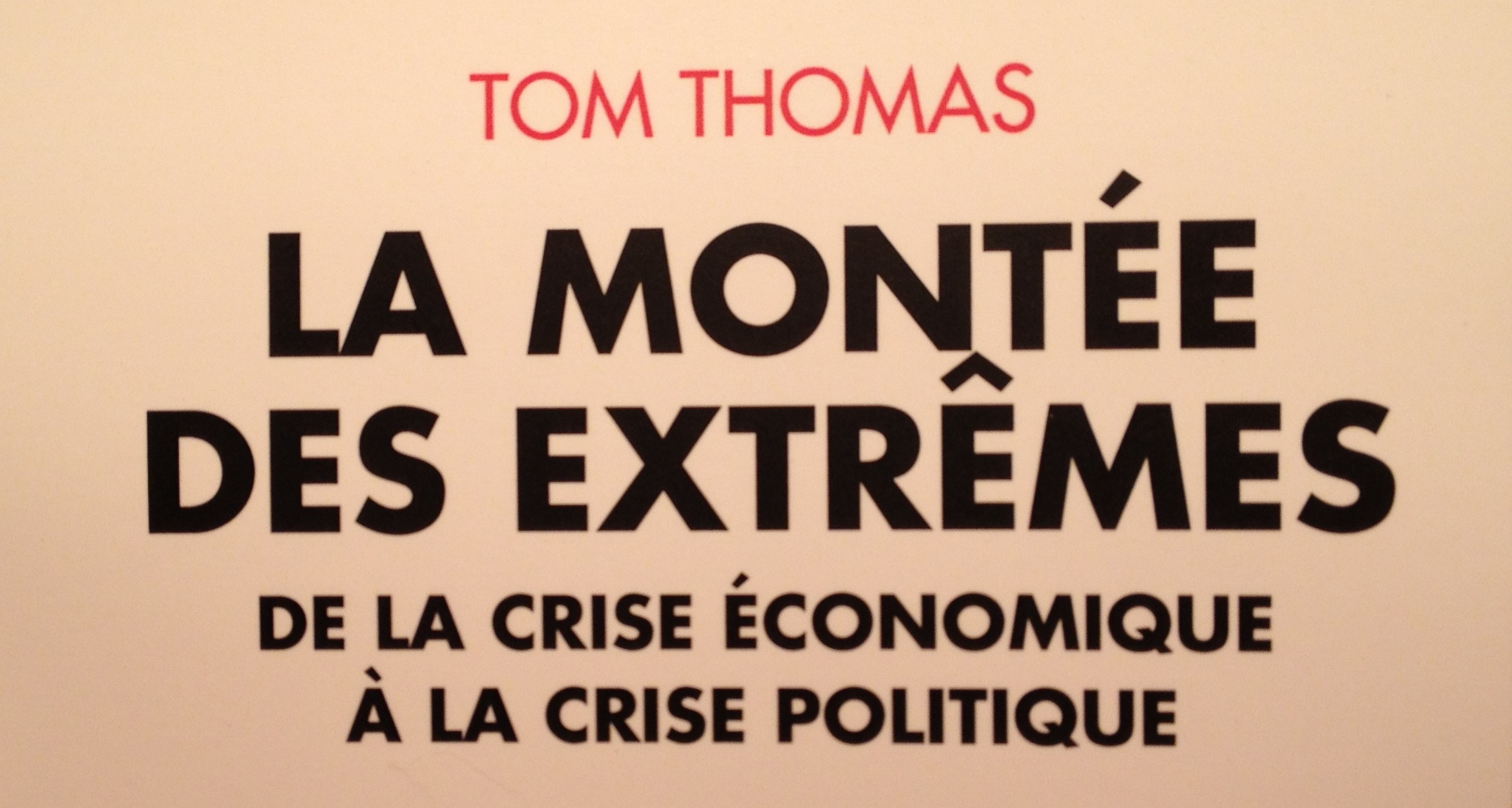
CHAPITRE 1 du livre de Tom Thomas « La montée des extrêmes »
La crise politique qu’engendre indubitablement la crise économique actuelle peut effectivement accoucher de l’arrivée au pouvoir d’un de ces extrémismes étatiques, dits populistes par celles et ceux qui seraient ainsi remplacés. Pour comprendre l’impasse, l’échec inéluctable et catastrophique d’un tel scénario, il convient d’abord de rappeler, en les résumant très brièvement, les principaux résultats de l’analyse de la crise contemporaine2.
1°) La reproduction élargie du capital – c’est-à-dire sa valorisation, son accumulation, dites « la croissance » pour en donner une image positive et neutre – s’est de plus en plus fondée, au fil du temps, sur les gains de productivité que permettent les progrès du machinisme, et cela plus particulièrement après la Première Guerre mondiale. Il s’agit de ce que Marx a brillamment analysé comme l’accroissement de l’extraction de la pl sous sa forme relative.
2°) Ce moyen induit deux effets conjoints et contradictoires. D’une part, une augmentation considérable de la masse des marchandises produites par la même quantité de travail social. De l’autre, en conséquence, un abaissement de la quantité de ce travail contenue dans chaque marchandise, c’est-à-dire de leur valeur, et par là de leur prix réel. D’où hausse du pouvoir d’achat des travailleurs. De sorte que, dans un premier temps, production et consommation augmentent conjointement. Mais pas dans les mêmes proportions. Et c’est là que le bât blesse, que se développe la contradiction annoncée ci-dessus qui dégrade progressivement l’accumulation du capital. En effet, ne serait-ce que pour maintenir le taux de profit (dont dépend toute décision d’investissement dans le capitalisme) dans une situation où la composante fixe du capital (la machinerie) augmente, celui-ci doit capter l’essentiel de ces gains de productivité. Ce qu’il fait en captant la pl additionnelle obtenue par cette augmentation de la production et consommation. D’où une croissance accélérée de l’accumulation du capital. De sorte que, finalement, la tendance inhérente aux gains de productivité aboutit toujours, et nécessairement, à ce que l’accumulation de moyens de production (ce capital fixe et ses approvisionnements en matières premières ou semi-finies) augmente plus vite que la consommation (la masse salariale). C’est pourquoi il se produit périodiquement des crises de suraccumulation de capital/sous-consommation des masses. Elles deviennent mondiales et généralisées à l’ensemble des branches de la production au fur et à mesure que l’aire de valorisation du capital devient mondiale ainsi que la chaîne de cette valorisation (division mondiale des processus de production). Tel fut le cas de celle des années 30, et, bien sûr, de la contemporaine.
3°) C’est toujours au niveau financier, au niveau du capital sous sa forme argent, qu’apparaît, ou pas, le profit (sous forme de dividendes, d’intérêts, de cours des Bourses, etc.). Il est donc habituel que les crises modernes éclatent d’abord comme crises financières (faillites bancaires, krachs boursiers). Cela d’autant plus que le capitalisme doit mobiliser une masse toujours plus considérable de capital argent, de crédit (via les actionnaires, les banques, les assurances, etc.) pour faire face aux investissements toujours plus massifs que nécessitent les développements de la machinerie, et doit aussi stimuler la consommation par le crédit. D’où le développement d’un capital financier, dont une bonne part s’avère être du capital fictif quand la crise révèle qu’il n’est pas du capital argent qui ait pu, voire même voulu, se convertir en capital en fonction, en moyens réels d’extractions de la pl, donc au cours d’un réel processus de production.
4°) Comme tous les krachs financiers du passé, dont il n’a différé que par son ampleur, c’est l’impossibilité de cette conversion, cette fictivité d’un capital financier « hors sol », qu’a révélée celui de 2008. La crise est ainsi apparue comme financière, et tous les experts en sont restés à cette apparence, certes frappante. Mais ce ne sont pas les « excès » de la finance, comme ils l’ont prétendu, qui en ont été la cause profonde. Ils furent seulement, et après que l’émission massive de crédits eut permis d’en retarder l’éclatement mondial, un facteur aggravant et l’élément déclencheur. La cause profonde, que révélait et cachait à la fois le krach, était dans la contradiction suraccumulation de capital/sous-consommation des masses rappelée au point 2 ci-dessus. Laquelle était arrivée à un niveau tel que des monceaux de capitaux se sont avérés fictifs ne pouvant pas se valoriser. Que ce blocage de la valorisation ait sa source dans les processus de production-réalisation de la pl eux-mêmes est flagrant aujourd’hui quand tant de moyens de production sont laissés à l’abandon, détruits, tandis que le montant des investissements stagne, voire régresse (décroissance), alors même que le crédit est offert massivement et quasi gratuitement par les Banques centrales faisant fonctionner la « planche à billets » à tour de bras, alors même aussi que les États s’endettent de manière pharaonique et dégradent la condition prolétaire afin de faciliter la production de pl. Avec si peu de succès que cela manifeste bien un blocage de l’accumulation (valorisation) du capital global.
5°) Mais la réalité ne se limite pas aux causes, somme toute classiques et bien connues depuis Marx, de la crise. Le point essentiel est qu’elle révèle une situation tout à fait nouvelle dans l’histoire du capitalisme : sa sénilité. C’est-à-dire que le capital a tellement bien réussi à augmenter la productivité, qu’il en est arrivé à ce stade, prévu de longue date par Marx, où la quantité de travail social est réduite à un minimum tel que la valeur d’échange des marchandises (cette quantité) devient insignifiante au regard de leur valeur d’usage. Le capital se heurte non seulement au fait bien connu que la quantité de travail vivant productif de pl qu’il utilise diminuant par rapport à celle du travail mort (la machinerie et ses approvisionnements), le taux de profit tend à baisser, mais également à ce fait nouveau que la valeur des marchandises elle-même (la totalité de ces quantités de travail qu’elles contiennent) a diminué à ce point que la valorisation se dégrade radicalement (la pl n’étant qu’une fraction de cette valeur finit par se réduire de manière absolue) et tend à se bloquer. Ainsi la tendance séculaire à la baisse du taux de profit devient, à l’âge sénile du capitalisme, tendance à la réduction de la masse du profit elle-même.
6°) Sans perspective de profits suffisants relativement à la masse des capitaux engagés, le capital ne peut s’accumuler puisque alors le capitaliste n’augmente plus, ou peu, son investissement. Les augmentations de productivité ne se font plus, ou beaucoup moins (phénomène bien constaté, sinon expliqué, par nombre d’économistes sous le nom de « rendements décroissants »). L’augmentation de l’extraction de la pl sous sa forme relative se bloque. En réaction le capitaliste (qu’il soit public ou privé, il n’est d’ailleurs question dans ces thèses que du capital en général) n’a plus alors comme solution que d’entreprendre de l’extraire sous sa forme absolue : augmentation de la durée du travail (hebdomadaire, annuel, sur toute la vie) ou/et de son intensité (augmentation de la quantité de travail fournie dans un même temps), qui plus est avec baisse des revenus prolétaires sous toutes leurs formes. Cela ne lui demande pas, ou peu, d’investissements supplémentaires, simplement de la vigueur et de la brutalité. Et lorsqu’il fait encore des investissements de productivité, il les négocie toujours durement contre une acceptation de ce type de mesures relatives à l’augmentation de l’extraction de la pl sous sa forme absolue (par exemple les accords dits « de compétitivité »). Mais cette forme n’engage aucune « spirale vertueuse » de croissance. Le capital se heurte alors en effet à trois obstacles majeurs. 1°) Ces mesures ne peuvent porter que sur une quantité de travail productif de pl qui ne représente aujourd’hui qu’une faible part de ses coûts, donc sont beaucoup moins efficaces qu’autrefois en termes d’augmentation du taux de profit. 2°) Ces mesures de « rigueur » étant prises par tous les capitalistes, elles entraînent un effondrement de la consommation, donc ruinent la transformation du surtravail en pl. 3°) Cette dégradation ouverte et brutale, directe et massive, des conditions de travail et de vie des prolétaires, et, au-delà, de la petite et moyenne bourgeoisie, exacerbe les récriminations, les résistances et conflits de classes, sapent les alliances de classes qui fondent le système d’État dit démocratique, qui convient le mieux au règne de la haute bourgeoisie. Ce qui aboutit à faire de la crise économique également une crise politique.
7°) La dégradation de la situation des couches populaires est d’autant plus massive et violente que la première réaction des États fut de parer à l’écroulement du système financier, lequel, sinon, aurait entraîné immédiatement celui du système de production tout entier, en nationalisant ses dettes et ses pertes. Autrement dit en en faisant porter la charge par les populations au nom de la « rigueur ». Non seulement cette « austérité » ne résout rien des causes profondes de la crise, les aggrave même en restreignant encore plus la consommation, mais l’émission hyper massive de monnaie qui l’accompagne mène tout droit à de nouvelles bulles financières, plus gonflées de capital fictif que jamais, et aux krachs qui s’ensuivront. Et finalement, cela ira jusqu’au défaut de paiement des États, dont la dette est irremboursable, sauf en monnaie de singe (hyperinflation), même pour les plus riches d’entre eux, ce qui, dans tous les cas, ruinera l’ensemble de ce système du capitalisme moderne fondé sur le crédit.
8°) Néanmoins la situation du capitalisme contemporain n’aboutira pas à ce qu’il s’écroule tout seul, mais à ce qu’il ne pourra plus se survivre qu’à travers des krachs financiers à répétition, des destructions de moyens de production pour lui excédentaires, des faillites d’États incapables de rembourser leurs dettes, une aggravation du chômage et de la pauvreté, des mutilations catastrophiques de la nature et de l’état de santé de la population. La croissance du capital en général ne peut y être qu’insignifiante, voire même tendra à être surtout rabougrissement sénile, décroissance. Les luttes pour l’emploi ne pourront donc pas aboutir à faire régresser un chômage croissant (partiel ou total). De même en ce qui concerne les luttes pour le niveau de vie puisque, outre cette croissance du chômage, la nécessité est aujourd’hui pour chaque capitaliste d’augmenter, pour ceux qu’il emploie, l’extraction de la pl sous sa forme absolue.
9°) Les peuples, les prolétaires en particulier, subissent donc aujourd’hui la double peine d’avoir à payer le remboursement (impossible) des dettes pharaoniques des États, et de gagner moins, tant en salaires directs qu’indirects, pour que les entreprises restent « compétitives », c’est-à-dire maintiennent le niveau des profits qui permette leur existence capitaliste.
10°) Dans ce contexte, le développement d’une profonde crise politique est une certitude. Elle a déjà commencé à apparaître dans nombre de pays européens (Grèce, Italie, Portugal,..) comme aussi ailleurs (Tunisie, Égypte, Turquie, Brésil,..). Évidemment avec des intensités, des formes et contenus divers, mais partout c’est l’État qui est visé, même si ce n’est encore le plus souvent qu’à travers son gouvernement et non en tant que tel. Marx avait prévu qu’un « développement des forces productives qui réduirait le nombre absolu des ouvriers, c’est-à-dire permettrait en fait à la nation tout entière de mener en un laps de temps moindre sa production totale, amènerait une révolution, parce qu’il mettrait la majorité de la population hors du circuit »3.
Mais nous savons, et les années 30 l’ont rappelé violemment, que toute crise politique n’accouche pas nécessairement d’une révolution, mais, hélas aussi de chambardements, plus ou moins superficiels en ce qu’ils ne sont que la continuation catastrophique du système capitaliste. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la crise économique induira une crise politique qui ne sera que cela, c’est-à-dire un changement du personnel politique de l’État par l’arrivée au pouvoir de partis prônant un étatisme renforcé à l’extrême comme soi-disant moyen d’établir un « bon capitalisme » au service du peuple plutôt que des financiers. Ou si elle enclenchera un processus pouvant aboutir à la destruction de l’État bourgeois en instaurant un pouvoir politique du prolétariat, apte à ouvrir et promouvoir la poursuite de ce processus révolutionnaire jusqu’à l’abolition des rapports d’appropriation qui sont le capital, apte à faire de sa sénilité une agonie et une fin.
Chacun va être acculé à devoir choisir entre ces deux directions opposées. La première semble la plus évidente et la plus facile à mettre en œuvre. Nous allons rappeler pourquoi, n’étant fondée que sur des fétichismes, elle serait une chute dans le pire, notamment un prolongement de la tendance au totalitarisme inhérente au capitalisme, et qui, de surcroît, ne résoudra rien de la crise économique, au contraire. C’est pourquoi, compte tenu de sa popularité actuellement croissante, c’est d’elle dont il faut parler en premier lieu, c’est elle qu’il faut combattre, et ce jusque dans les formes les plus masquées qu’elle prend quand elle est portée par des idéologues et partis de gauche.

